RECUEILLEMENT

RECUEILLEMENT

SUR LES TRACES D'ISABELLE EBERHARDT
Grande appréhension et émotion pour moi en franchissant la porte de ce vieux cimetière sous un soleil ardent, il était exactement midi dix, il
n'y avait personne qui pouvait me guider vers sa tombe bénie, je jetais un regard circulaire autour de ces tombes inconnues et presque effacées,
mon instinct me guida droit vers une tombe aux pierres tombales hautes et c'était bien sa tombe, une immense tristesse m'étreignit le coeur mais
juste après avoir récité quelques versets du saint coran à la mémoire de la défunte, une paix indescriptible gagna tout mon être
Mais que d'émotions
Ce pèlerinage me tenait à coeur depuis bien longtemps , ce passage dans l'un de ses écrits me traversa l'esprit:et me bouleversa
Sous quel ciel et dans quel contrée reposerais-je , au jour fixé par mon destin ?
Mystère ....Et cependant je voudrais que ma dépouille fût mise dans la terre
rouge de ce cimetière de la blanche Annaba , où elle ( sa mère ) ..ou bien , alors ou
n ' importe où , dans le sable brûlé du désert , loin des banalités profanatrices de
l ' Occident envahisseur ..
Voeux exaucés , elle repose sur ce sable brulant du désert au milieu de ces gens et de ces espaces qu'elle a tant aimé et ce dans le vieux
cimetière musulman de sidi Boudjemaa (Ain sefra)
Mais que de mensonges colportés à l'égard de cette femme hors du commun qui nous a tant aimé et que nous aimons beaucoup
Pour rappel Isabelle a été emportée par une crue d'oued Ain Sefra le 21 octobre 1904 à l'âge de 27 ans
ET MERCAN PIRATESTIS DE LETTRES ( A propos d'Isabelle EBERHARDT - Sa vie et son oeuvre
Je m'excuse auprès de mes lecteurs d'interrompre encore une fois mon étude sur l'œuvre de notre camarade Han Ryner. Cette fois, heureusement pour moi, ce n'est pas pour raison de santé, mais parce qu'un acte inouï de mercantilisme littéraire vient .d'être commis à l'adresse de celle que- j'ai baptisée « La Bonne Nomade » et que Séverine appelait la « Louise Milchel du Sahara ». Après avoir, voici dix ans, écrit sur elle un livre aujourd'hui introuvable, j'ai, l'an dernier, à cette époque, consacré, ici-même, à la vie et à l'œuvre d'Isabelle Eberhardt, une longue étude au sujet de laquelle je reçus des félicitations nombreuses ; c'est pourquoi il m'a été impossible de ne pas m'élever sans le moindre retard, et avec toute l'énergie dont je suis capable contre un véritable crime littéraire dont sa mémoire vient d'être encore une fois victime de la part d'un certain Doyon, ancien commis de librairie chez un éditeur en faillite, un cacographe et pisseur d'encre qui se prétend homme de lettres. Mais avant d'exposer l'acte de mercantilisme littéraire dont ce monsieur s'est rendu coupable, il est nécessaire que je raconte ici l'acte de piraterie commis, voici 14 ans, à l'égard de notre défunte camarade, par M. Victor Barrucand, l'auteur du Pain gratuit, anarchiste repenti, devenu journaliste bourgeois à la solde de ia Défense algérienne, organe de la ploutocratie nord-africaine. Han Ryner et son œuvre ne perdront rien à ce surcroît de réflexion et de méditation, étant donné que mes articles à leur propos sont destinés, dans mon esprit, à reparaître plus tard sous la forme plus durable d'une forte brochure.
1 UN PILLEUR D'ÉPAVES :
M. Victor Barrucand Le scandale fut grand, en Algérie, quand, au cours de l'année 1909, Ernest Mallebay, le vigoureux polémiste dénonça le premier et fliétrit dans ses Annales africaines de pirate de. lettres qui avait essayé de voler à la bonne Isabelle Eberhardt sa (belle et dolente gloire posthume .La presse algérienne, comme on le verra tout à l'heure, le soutint, et avec lui cloua au pilori le cynique d'étrousseur. Telles furent la vigueur et l'éloquence de sa campagne que remontant déjà à quatorze ans, le souvenir est resté bien vivant dans notre Afrique septentrionale. C'est qu'en effet il réussit à indigner non seulement les nombreux hommes de lettres du nord-africain, mais encore l'opinion publique toute entière que la vie à la fois si courte et si douloureuse de la douce Vagabonde avait touchée jusqu'au fond de l'âme. On savait que la jeune femme avait été une de ces créatures d'élite, comme on n'en voit que de loin en loin et sa fin tragique dans les eaux boueuses d'Aïn-Sefra ajoutait quelque chose de plus poignant à son auréole. On savait encore qu'elle ne s'était pas contentée de 'narrer en des pages qui survivront, les misères du bédouin dans les splendeurs tristes du « bled », mais qu'elle les avait vécues, aimées, soulagées tout en les magnifiant dans sa prose de larmes et de tendresse
 .
.
On savait, enfin, qu'elle avait été l'amoureuse ardente et pauvre du désert où elle repose aujourd'hui près de ses amis les « meskines » (les pauvres)sous l'humble tombe musulmane vénérée de tous les nomades, autant qu'une kouba maraboutique. Tout cela explique pourquoi fut si profonde l'émotion quand, par les Annales africaines, on apprit que M. Victor Barrucand, s'emparant des manuscrits laissés par la morte, non content de les tripatouiller, les avait publiés, d'abord en accolant son nom à ,celui de la jeune femme, puis, s'enhardissant, avait poussé le cynisme jusqu'à ne laisser que le sien dans les annonces et les réclames qu'il lançait en vue de la vente. Là ne s'arrêtèrent ipas les découvertes et les révélations du sagace polémiste. En .feuilletant le supplément du Dictionnaire Larousse, il trouva que M. Barrucand dans sa « notice biographique », se donnait comme le seul auteur du chef-d'œuvre d'Isabelle Eberhardt : Dans l'ombre chaude de l'Islam, et qu'il n'était pas plus question de celle-ci que si elle n'avait jamais écrit et souffert sur la terre algérienne à laquelle, pourtant, elle se donna corps et âme Mais Barrucand fit mieux encore, si j'en juge par ce que la Revue nord-africaine .publia lorsque parurent, en 1909, mes Visions sahariennes. Lisez plutôt : « ... Certes, il y a de bien belles pages dans l'œuvre d'Isabelle Eberhardt, et Dans l'ombre chaude de l'Islam, pour être un chef-d'œuvre moins complet que Visions sahariennes, a cependant beaucoup d'attrait... Mais comme beaucoup, comme le docteur Trenga lui-même, dans son étude sur la littérature algérienne parue dans cette revue, en mai 1905, (M. Vigné d'Octon pourrait bien avoir fait erreur (1). Isabelle Eberhardt, en effet, n'aurait presque rien composé de son œuvre posthume. C'est du moins ce qui ressort des paroles mêmes de M. Barrucand qui, dans l'Akhbar du 28 mai 1905, n'hésite pas à -dire que le manuscrit de la pauvre morte d'Aïn-Sefra ne contenait AUCUNE PAGE INTACTE OU ACHEVÉE..; » Ainsi donc le forban avait eu l'audace de biffer d'un coup de plume insolent tout le magnifique labeur de notre chère et grande Morte ! Il avait osé écrire qu'il ne restait plus rien ou à peu près du manuscrit retrouvé dans la terre boueuse d'Aïn-Sefra, après la terrible inondation, alors que des témoins, parmi lesquels, me dit-on, le général Lyautey lui-même, qui commandait à Aïn-Sefra, avaient déclaré qu'il était quasiment intact, n'avait presque
(1) J'avais fait dans mes Visions Sahariennes un éloge enthousiaste du beau livre d'Isabelle Eberhardt
pas souffert, et restait, d'un bout à l'autre, fort lisible. En vérité, Ernest Mallebay n'avait-il pas raison de clamer à tous les vents : « Non ! non ! il ne s'est jamais rencontré, dans l'histoire des lettres françaises, un pillard plus cynique et plus effronté !» Dans les milieux littéraires parisiens où je vivais et où la révélation, de ce vol provoqua tout de suite un émoi profond, certains, et parmi ceux-là Jean Hess voulurent y voir une manifestation de ce qu'ils appelaient la mentalité algérienne. Et ils eurent l'air d'englober peu ou prou, dans le cas Barrucand, la plupart les journalistes et des homme» de lettres -du Nord de l'Afrique. Je protestai alors avec énergie contre cette opinion en écrivant : A défaut d'autres preuves, la quasi-unanimité des publications algériennes à seconder Mallebay dans sa campagne de salubrité publique ne suffit-elle pas à démontrer l'injustice profonde à les faire solidaires du forban des lettres ? Pour n'oublier aucun nom parmi ceux qui le lardèrent de leurs meilleures flèches, il faudrait prendre la liste complète de nos confrères dans l'Annuaire de l'Algérie. Affolé, Barrucand pensa qu'il n'était guère qu'un moyen de sauver la situation c'était de poursuivre Ernest Mallebay et sa revue en diffamation devant le tribunal correctionnel d'Alger. Fort de -l'appui de la Défense algérienne, à laquelle il collaborait, il escomptait contre le probe et vigoureux polémiste une condamnation sévère qui le blanchirait luimême devant l'opinion publique. Mal lui -en prit, car les débats furent écrasants pour lui, et les juges, bien qu'ardemment sollicités, estimèrent à vingt sous son honneur qu'il prétendait outragé. II Jonnart le Massacreur et ma Bonne Nomade Telle est, sommairement mais fidèlement racontée, l'histoire du vol commis à l'endroit de Ma Bonne Nomade par M. Victor Barrucand, ex-anarchiste devenu le plat valet d'un grand journal capitaliste. Et maintenant, avant d'exposer l'acte- de vil mercantilisme auquel vient de se livrer à son égard le sieur Doyon, je crois utile de narrer sobrement à mes lecteurs comment je suis devenu l'admirateur de notre chère camarade, de la « Louise Michel du Sahara », et dans quelles circonstances eut lieu, sur la terre d'Afrique, ma première et unique rencontre avec elle. C'était en 1903, alors que je siégeais encore au Palais Bourbon. La conquête du Maroe oriental (Gourara, Tidikelt, Touat), dont j'ai narré les horreurs dans Terre à galons, battait son plein.
Au mois de mai de cette année-là, l'ignare et sinistre Jonnart, après un bombardement aussi sauvage qu'inutile des oasis du Figuig, avait fait massacrer des enfants, des vieillards, des femmes, toute une population pacifique qui ne demandait qu'à commercer paisiblement avec.nous. Il avait fait cela d'abord pour pouvoir dire : « C'est moi, Jonnart, qui par ma victoire du Figuig ai doté la France de ses riches oasis ! » Et il avait fàit cela aussi pour se venger de la fameuse échauffourée, du guetapens dont il venait d'être le lamentable héros au col de Zénaga, guet-apens dont il accusait les pacifiques Figuiguiens, alors que les auteurs étaient des Beni-Guil et des Doui-Ménie descendus des monts voisins. Telle avait été sa frousse lorsque la fusillade crépita autour de lui, que le général O'Connor qui l'accompagnait et les officiers de son escorte en furent abasourdis. Je me souviens parfaitement que si à l'extrême-gauche, nous fîmes des gorges chaudes autour de cet incident,quand nous en connûmes les détails, racontés par le général O'Connor lui même, il n'en alla pas de même lorsque, peu après, on apprit le bombardement de l'Archipel et le massacre d'innocents qui en furent la sanglante conclusion. Bientôt après arrivait la nouvelle de l'affaire non moins sanglante d'El - Moungar. Décidément, Jonnart continuait à mettre à feu et à sang l'extrême- sud oranais. Je déposai une demande d'interpellation, et sur l'intervention du général André lui-même, alors ministre de la guerre, j'eus les honneurs du renvoi à un mois, c'est-à-dire d'un enterrement de première classe. Ce que voyant, et désireux, comme toujours en ces cas, de me documenter sur les lieux, je partis pour l'extrême-sud oranais. Fin novembre 1903, j'arrivai à Aïn-Sefra. Sur le registre du. petit hôtel où je dus inscrire mon nom, j'eus le plaisir de lire celui d' « Isabelle Eberhardt, publiciste ». Justement, en passant à Alger, j'avais lu d'elle, dans un grand journal du pays, une exquise nouvelle intitulée M'tourni. Je connaissais d'elle également d'autres récits sahariens, où étaient racontés avec une profonde sympathie les misères des « meskines » du désert. En 1902, j'avais remarqué, signées d'elle, dans la Revue blanche, des pages d'un exotisme pénétrant sur Tuni«, et dans la Dépêche algérienne, ces merveilleuses silhouettes arabes qui ont pour titre Meddah, Le Sorcier, L'Enlumineur sacré. Enfin, j'avais savouré dans les Nouvelles, un troublant récit intitulé Retour. Toutes ces pages éclairées par la grande lumière d'Afrique, empreintes d'une pitié profonde, d'une pitié à la Louise Michel, pour la misère des vaincus, ces pages enfin, dans lesquelles on sentait palpiter l'âme même du désert, m'avaient frappé autant que la vie étrange de celle qui les écrivit. L'occasion s'offrait donc très belle de lui dire tout le bien que rje pensais, non seulement de son talent, mais aussi et surtout, de son âme compatissante et le son grand cœur. « Est-ce que Mme Isabelle Eberhardt est ici? deanandai-je à l'hôtelier. — Non, monsieur, me répondit-il, elle ne s'est arrêtée que trois jours et est partie pour Beni-Ounif et Béchar, où ça va barder. — Bien, pensai-je, je suis à peu près sûr de l'y rencontrer. » Après trois jours passés à Aïn-Sefra, je pris le train pour Beni-Ounif. Au fur et à mesure que la locomotive poussive s'enfonçait dans le sud, de plus en plus lamentable, défilait des deux côtés le désert dantesque de cet extrême sud oranais. Bien que neuves, les gares de Djenien-ben-Res, de Duveyrier, de Djenien el Dar se dressaient, dans cette immensité aride, pierreuse, rocailleuse, tantôt carbonisée par la canicule, tantôt balayée par les vents glacés. Djenien el Dar clame une voix. Le train stoppe. Et voici que la halte annoncée de dix minutes se prolonge indéfiniment. Le bruit se répand d'une panne qui immobilisera longtemps encore notre locomotive essoufflée. Je n'ai pris avant de partir qu'une tasse de café, et j'ai commis l'imprudence de m'embarquer sans la moindre provision. Des crampes commencent à me tirailler l'estomac, lorsque, par la portière, j'aperçois près de la gare une bicoque aux apparences d'estaminet. « Oui, oui, me dit le chef de gare à qui je la montre, vous pouvez y déjeûner ; et regardant la montre et la locomotive, il ajoute, d'un air à la fois comique et navré : Vous avez le temps. » Les yeux .éblouis par la grande lumière du dehors, je ne vois d'abord rien, en entrant, puis petit..à petit, je distingue les détails de cet intérieur d'estaminet. J'aperçois derrière le vaste comptoir, une boîte de bois blanc recouverte de toile cirée, devant laquelle est assis un cavalier arabe en train de piquer dans une boîte de sardines, une fourchette de fer blanc. Il me tourne le dos et je ne vois que son haut turban en forme de tiare autour duquel s'enroulent, fauves et multiples, des cordelettes en poil de chameau, les vastes plis du blanc burnous bouffant aux épaules et sous la chaise le rouge luisant de ses bottes en cuir du Maroc. — « La table n'est pas grande, mais il y a. place pour deux, me dit l'hôtelier en me montrant l'autre côté. — « Et même pour trois, ajoute d'une voix qui est celle d'une femme
Isabelle Eberghardt en costume nomade vers 1900

Un front pâle, bombant sous la ligne courbe du turban, de clairs sourcils et entre de longs cils cendrés, des yeux d'un douceur infinie, des dents très blanches, ornant une bouche un peu grande, mais aux lèvres fines, voilà ce que je vis dans un rayon de soleil filtrant par les fissures d'un volet disjoint. Et plus douce encore que le regard était la voix que j'entendis. — Isabelle Eberhardt, fis-je en m'avançant vers la chaise qu'elle me montrait en face d'elle. — Moi-même, Monsieur, vous me connaissez donc ? — Non, Madame, je vous reconnais. — A mon costume, sans doute ? — Oui, Madame, mais aussi, parce que j'ai appris à Aïn-Sefra votre présence dans l'Extrême-Sud. — Hélas ! fit-elle alors tristement, pas pour longtemps, mes beaux jours sont finis, ma mission terminée et je rentre à Alger par le train qui va monter quand le vôtre sera parti. Et vous, vous allez à Ounif et à Bedhar ? — Oui, Madame, en qualité de journaliste comme vous. Son front s'éclaira, son regard se fit encore plus doux : — Ah ! un confrère ! Enchantée, Monsieur, et elle ajouta avec une moue des lèvres difficile à interpréter : Vous verrez des choses bien drôles... (une pause), vous verrez des choses héroïques... (une autre pause) et, hélas ! d'autres bien tristes aussi... Alors du capuchon de on burnous, sortant deux gros carnets et des feuillets noircis : — Voici mes notes, dit-elle, je rédigerai tout ça à Alger, pendant les jours tristes de cet hiver. Mais pour y aller je vais prendre le chemin des écoliers. Je passerai par Géryville et Aflou. Cela fera contraste avec le Figuig... Elle se tut un instant, et, au moment où j'ouvrais la bouche pour lui demander des détails . — C'est pour la première fois, reprit-elle, que vous venez dans l'Extrême-Sud oranais ? — Non, Madame, mais lors de mon dernier voyage le train s'arrêtait à Duveyrier. — Eh bien ! puisque vous ne connaissez pas le Figuig, ne manquez pas de le visiter, l'archipel est merveilleux. Elle hésita quelques instants, jeta autour d'elle un regard de méfiance, et sur un ton plus bas : Vous en apprendrez de belles sur les exploits de M. Jonnart... A ce moment l'hôtelier m'apportait l'inévitable boîte de sardines dans une assiette d'une propreté douteuse, munie d'une fourchette aux pointes tordues, et il posa à côté, roulés dans un papier jaunâtre et huileux, quelques ronds de saucisson. — Menu égalitaire, cher confrère, observa la jeune femme en riant, vous le retrouverez dans tous les estaminets d'ici. Elle achevait à peine ces mots et je cueillais une sardine à la pointe de la fourchette, lorsque, par la porte grande ouverte du caboulot, la voix du chef de gare cria : « On part, Monsieur, on part, la locomotive est réparée, emportez votre déjeuner. » Et, en effet, la machine retapée lâcha des sifflements aigus à nous déchirer le tympan. Navré du contre-temps, j'empochai vivement pain, saucisson, boîte de sardines, tandis qu'Isabelle Eberhardt, de sa voix très douce, me disait : « On se reverra à Alger, à votre retour du Sud. » — Oui, Madame, je ne quitterai pas l'Algérie sans vous revoir. Je serrai sa main fine et blanche de thaleb, qu'elle me tendait ; mais elle voulut m'aceompagner jusqu'au train : — A Alger ! — A Alger ! — Et surtout allez au Figuig ! Un dernier adieu des mains, et le train fila... Et je ne devais plus la revoir... Quand je revins à Alger, après m'être attardé de longues semaines sous les palmiers et dans les « ksour » d'El-Maïz, d'Hammam-Tahtani, d'Hammam-Foukaniet d'El-Oudarir, elle était partie pour le Maroc, d'où elle envoyait aux journaux d'Alger, de belles pages sur Oudjda. De mon côté, repris dès mon retour à Paris, par la double bataille politique et littéraire, je ne pensais plus à la troublante jeune slave ou plutôt, son souvenir 's'était endormi lentement dans les limbes de mon cerveau... Quelques mois après, par une matinée triste et brumeuse d'automne (on était à la fin d'octobre 1904), comme j'entrais au Bois de Boulogne, pour y faire ma promenade quotidienne, j'ouvris le Journal et mes yeux tombèrent sur .une dépêche d'Alger, annonçant en quatre lignes, la mort tragique d'Isabelle dans le torrent débordé d'Aïn-Sefra. Je repliai le journal, ne voulant, à ce moment, connaître d'autres nouvelles que celle-là afin de laisser la tristesse qui s'en exhalait me pénétrer tout entier. Sur ma tête les nuages du ciel parisien me parurent plus noirs et plus sombres et il me sembla que les frondaisons des grands arbres pleuraient... Les feuilles mortes tombant lentement sur la terre humide étaient leurs larmes, des larmes pareilles à celles que je refoulais... Et je revis sous son aspect lamentable, le triste bourg militaire de la Haute-Oranie, avec ses maisons de boue grise, ses dunes endeuillées, ses maigres platanes et ses peupliers échevelés comme des pleureuses antiques jetant leur « thrène » au vent glacé des plateaux... Je revis aussi l'oued,

terrible roulant, dans ses flots boueux, le corps de la jeune femme, de cette Louise Michel saharienne, dont le grand cœur et le talent, autant que la vie douloureuse et magnifique. m'avaient si profondément ému et troublé... • Enfin, je revécus les minutes si brèves de ce matin de décembre, où, pour la première fois, dans le pauvre estaminet de Djenien-el-Dar. j'avais vu son front pâle bombant sous le haut turban du cavalier et ses yeux d'une douceur infinie et sa main blanche de thaleb... j'entendis sa voix, non moins douce et qui était comme une caresse qu'elle faisait à l'air léger. — A Alger ! A Alger ! à votre retour... :.. Et maintenant c'était la Mort... III Une limace sur la rose D'autres années passèrent, pendant lesquelles, j'écrivis un livre sur elle : Isabelle Eberhardt ou la Bonne Nomade, après avoir eu le bonheur de découvrir au cours de mes recherches, une longue nouvelle inédite, intitulée Mektoub, et que je donnais en même temps. Puis je. résolus de réunir en un volume les nouvelles, impressions, contes et récits algériens et sahariens, qu'Isabelle Eberhardt avait éparpillés dans des revues de France, et surtout dans les journaux d'Algérie. J'avais trouvé comme titre à cette oeuvre : Sur la flute bédouine.. Elle serait précédée d'une longue étude biographique et littéraire. Parmi les documents originaux que je possédais sur Isabelle Eberhardt se trouvait la lettre suivante qui me fut écrite par M. N'çibHammon ben Ali, beau-frère et héritier d'Isabelle Eberhardt, en réponse à une lettre dans laquelle je lui demandais l'autorisation de publier Mektoub, et aussi de me communiquer tous papiers et manuscrits intéressants laissés par sa glorieuse belle-sœur. L'autorisation accordée, M. N'çib ajoutait : « Je vous adresse ci-joint ces documents (prouvant mes droits d'héritier). Quant aux autres papiers, ils se composent de la moitié d'un sac de la capacité de contenir huit décalitres et en une dizaine de gros cahiers, dont plusieurs portent encore la boue de la catastrophe d'Aïn-Sefra. » Enfin le beau-frère d'Isabelle Eberhardt, terminait sa lettre en me proposant de me vendre, après examen sur les lieux, les sus-dits papiers. Je connaissais déjà leur existence par Barrucand depuis 1907. « Je les connais tous, m'avait-il dit, ils n'ont aucune valeur littéraire. Il y en a d'ailleurs beaucoup en langue russe et le restant n'est même pas écrit en français. » Je me rappelais ces paroles en relisant La lettre de N'çib ben Hammon, et ne voulant pas faire un voyage inutile, j'écrivis à un ami, fonctionnaire, qui habitait Bône, à ce moment, et avait beaucoup connu Isabelle Eberhardt. Je le chargeai de se renseigner sur la valeur de ces papiers, au point de vue d'une publication Sa réponse confirma l'appréciation de Barrucand. « Ce sont, me disait-il en substance, des épluchures, des rogatons, plutôt que des notes, qu'Isabelle enfouissait dans la profondeur de ses poches, n'ayant pas de panier pour les y jeter. Les mettre à jour ne pourrait que rabaisser le mérite de celle qui écrivit : Dans l'ombre chaude de l'Islam. Ce serait comme si, pour évoquer l'œuvre d'un grand sculpteur, on exposait les fragments de marbre qui tombèrent sous ses ciseaux. » Or, voici qu'aujourd'hui, dans un but de lucre, un certain Monsieur Doyon, marchand de papier, vaguement éditeur, vient de publier, après les avoir tripatouillés à sa façon une partie de ces papiers. Je suis certain que le nom seul de notre pauvre camarade sur lequel il a spéculé, fera vendre son bouquin, et comme Barrucand, il empochera, sans scrupules, de la galette, beaucoup de cette bonne galette, qui devient de plus en plus rare et précieuse par le temps qui court. Je l'entènds me répondre : « Mais j'ai acheté ces manuscrits et j'en ai remis en bonnes espèces sonnantes le prix à Mme X qui les possédait, les ayant elle-même achetés de Mme Y. — C'est entendu, lui dirai-je, en bon marchand de papier, vous avez écrit sur vos livres : Versé à Mme X... Mais voyons, aurezvous la franchise de mettre ici le chiffre exact? Si mes renseignements le sont, il s'agit d'une somme dérisoire, un véritable prix de brocanteur juif spéculant sur le « bicot ». Et aurezvous ensuite la franchise de nous dire, au moment opportun le chiffre précis de la recette ?
Je n'insiste pas sur ce mercantilisme naturel d'ailleurs, étant donné la profession du sieur Doyon, et je le lui pardonnerais volontiers, s'il n'avait odieusementtripatouillé les papiers d'Isabelle ; ne donnant que les textes qui lui plaisaient, éliminant, par exemple, en bougonnant, les cris de colèie contre les exploiteurs de l'indigène, contre l'es grands usuriers et les mauvais colons, qui s'exhalaient chaque jour de son âme révolutionnaire et qu'elle fixait d'une main tremblante sur le papier, oubliant, même à ces moments, d'écrire en français. Ce que je ne lui pardonne pas non plus, c'est relativement à la mauvaise notice biographique qu'il a cru bon d'ajouter à son bouquin commercial, de m'avoir volé, en le galvaudant, ce nom si doux : La bonne Nomade, dont je fus le premier à la baptiser. Pauvre petite Isabelle, que tu dois souffrir sous la dune d'or qui t'abrite de .voir ta merveilleuse et courte vie, ainsi que ton souvenir d'outre-tombe pollués, flétris, par des mercantis assoiffés d'argent, de cet argent que ton âme de libertaire méprisa jusqu'à la haine ! Oui, que tu dois souffrir du contact forcé de ce marchand, toi qui ne voulus rien posséder sur cette terre, pas même un morceau de cette toile, déchirée, battue des vents, sous .laquelle s'abrite le plus misérable bédouin ! Ecoute, petite sœur de ma pensée : A l'heure où j'écris ces lignes, sous les micocouliers de mon ermitage cévenol, tout près de moi, une horrible limace se promène en bavant sur la plus belle de mes fleurs et il me semble voir le scribe éhonté, le marchand cupide, le pied-pla.t aux ongles noirs flétrir la fleur de ton rêve et de ta vie ! Oh ! je le sais, tu as déjà pardonné ce 'amentable brocanteur, comme tu pardonnas tous ceux : officiers stupides, fonctionnaires cruels, qui te tourmentèrent, à cause de ta pensée libre pendant ton séjour ici-bas. Et à mon tour, je pardonne, pour rester le digne gardien .de ton Souvenir.

La dernière photo d'Isabelle Eberhardt
AUTOUR DE LA MORT D'ISABELLE EBERHARDT
Mme Eberhardt a passé à l’hôpital la nuit du 20 au 21 octobre. Elle l’a quitté le 21 au matin, entre huit et neuf heures, plutôt vers neuf heures. Que de fois n’avons-nous pas évoqué, depuis, entre légionnaires, la figure et les allées et venues de la Russe et déploré l’abominable fatalité qui la conduisit à la mort ! Elle aurait retardé d’une heure sa descente de l’hôpital qu’elle échappait à son destin funeste. Mais, comme on dit, quand on est marqué pour la mort, il n’y a rien à faire pour la tromper. Voici quelques indications. Le 21 au matin, j’avais été désigné au poste de planton au bureau de la compagnie en garnison à la Redoute. Le terrain militaire qui porte ce nom enferme trois grands bâtiments et des baraquements ; on peut loger là bon nombre de soldats. La Redoute domine la ville d’Aïn-Sefra de 60 à 70 mètres ; des sentiers assez rapides la relient à l’agglomération civile. Tous les services de la garnison, l’hôpital y compris, sont groupés, sauf la sous-intendance, à la Redoute. La ville est séparée du quartier militaire par le ravin d’un oued torrentueux qu’enjambait alors un pont. Le lit de l’oued, en temps ordinaire, était toujours à sec. Aussi les soldats avaient-ils l’habitude d’emprunter les sentiers de chèvre qui traversaient le ravin pour gagner le centre du patelin sans passer par le pont. Ils abrégeaient la route. Vers neuf heures, le sergent-major m’envoya en ville porter des pièces à la sous-intendance. Je ne m’attardai pas à flâner et étais de retour à la Redoute aussitôt après la sonnerie de la soupe. Je courus prendre ma gamelle et me précipitai à la cuisine. Je m’en retournai alors au bureau et posais ma gamelle sur une table pour commencer mon repas, quand le fourrier, alors debout près de la porte restée ouverte m’appela. — Kohn, viens donc voir ça, bon Dieu, que c’est curieux. Dépêche-toi ! Parole, tout le patelin en bas se couvre d’eau ! Et écoute ce tapage !
Je le rejoins au plus vite et m’exclame… Un torrent jaune avec d’énormes bouillons d’eau se précipite dans le ravin de l’oued, entre la ville et le camp ; il charrie à grand fracas des tas de saloperies, des arbres, des zeribas. Voilà que l’eau envahit les quartiers où je m’étais rendu tout à l’heure comme un fleuve plein de rapides et de remous qui tourbillonne et s’élargit en montant et les communications se trouvent coupées avec l’agglomération. Soudain retentit un bruit de tonnerre ; et je vois s’effondrer la moitié du pont qui franchit le ravin. À cette heure de la matinée il y avait très peu de militaires à Aïn-Sefra civil : les clairons avaient sonné la soupe ; les légionnaires déjeunaient. Les officiers eux-mêmes habitaient presque tous à la Redoute et y prenaient leurs repas dans leurs popotes. À ce moment nous étions tous assemblés devant le camp ; de là nous assistions, empoignés par l’angoisse, à l’engloutissement de la ville par l’inondation. Nous nous demandions de quelle façon nous pourrions venir en aide aux habitants. Un de nos camarades, un soldat lorrain nommé Beck, aperçut le postier, sa femme et un petit enfant qui se cramponnaient au toit de leur maison, sur lequel ils s’étaient hissés ; ils étaient en danger imminent de mort. Beck, un chic type, essaya de sauver les malheureux ; il se jeta à l’eau. Il ne parvint pas à rompre le courant ; il sortait de table ; saisi par une congestion, il fut roulé et entraîné par les eaux furieuses et disparut à nos yeux. On ne retrouva son corps que deux jours après. Pendant ce temps le toit sur lequel s’étaient réfugiés le postier et sa famille, qui criaient au secours, s’abîma sous la poussée du courant qui charriait des troncs d’arbres et roulait jusqu’à des roches, et les malheureux furent emportés à leur tour. À ce moment toute la partie basse de la ville était submergée. Ce ne fut que vers quatre heures de l’après-midi que des copains et moi avec eux réussirent à lancer une solide corde de l’autre côté du torrent, où des sauveteurs l’attachèrent convenablement. Ceci fait, nous essayâmes, en nous cramponnant à la corde, de traverser l’oued, dont la décrue avait d’ailleurs commencé. Nos efforts furent vains. L’eau était glacée ; il nous était impossible d’y séjourner longtemps.
Lyautey nous envoya l’ordre d’interrompre notre entreprise, qui était au-dessus des forces humaines comme il dit. Ce ne fut que très tard dans la nuit qu’à la lumière des lanternes nous parvînmes à construire un pont de fortune ; nous utilisâmes à cet effet des prolonges d’artillerie, des charrettes et des arabas. L’eau baissait rapidement et le courant avait de moins en moins de force. Le lendemain, à la première heure, Lyautey organisa une équipe dont je fis partie, sous les ordres d’un lieutenant : elle avait pour mission de découvrir Isabelle Eberhardt dont on avait appris la disparition. Isabelle occupait une maisonnette à un étage dans le quartier riverain de l’oued. Laissez-moi signaler ici qu’aucune des constructions de ce quartier si exposées aux crues ne s’effondra, alors que d’autres plus éloignées s’écroulaient. Parmi celles qui s’abattirent sont l’école où une dizaine d’enfants se noyèrent, et plusieurs maisons de tolérance où périrent de nombreuses pensionnaires. L’habitation d’Isabelle était plutôt un gourbi qu’une maison. Le rez-de-chaussée était en contre-bas de la rue et on y descendait par une ou deux marches. Nous arrivâmes sans trop de peine, mes camarades et moi, à cette masure située dans une rue maintenant crevassée, boueuse, encombrée de dépôts de pierres et de toutes sortes de décombres puants entassés par l’inondation. Nous éprouvâmes beaucoup de peine à ouvrir la porte derrière laquelle s’était amassés des débris et à pénétrer dans la maison. Le rez-de-chaussée avait été à demi comblé par des apports de fange et de pierres détachées par le torrent. La façade était lézardée, mais aucun autre dommage n’apparaissait à l’étage supérieur. C’est dans cette boue que nous nous frayâmes un chemin. La pièce était très basse de plafond. Dans le fond, en face de l’entrée s’élevait, plaquée à la muraille, une sorte d’escalier rudimentaire qui accédait à la chambre de l’étage. On respirait là un air empesté. Dans l’obscurité du grossier réduit formé par la volée de l’escalier j’entrevis des pieds humains qui sortaient d’un monceau de débris. Nous écartâmes sur-le-champ ceux-ci. Sous une grosse planche que nous dûmes rejeter gisait le cadavre aux jambes repliées d’Isabelle revêtue de son costume de cavalier arabe. Je suppose que peu après son arrivée chez elle, elle fut surprise par l’arrivée du mascaret. J’ai constaté, aux traces laissées par l’eau limoneuse sur les murailles de la chambre, que la crue y avait dépassé la taille d’un homme. À mon estime, quand nous fîmes la découverte du corps, il y avait vingt heures environ qu’elle avait cessé de vivre. Aidé par un camarade je recouvris le corps d’une couverture sous la direction de mon officier. Voici comment a dû se produire l’accident. J’ignore la version officielle qu’on en a donnée. Mon opinion est simplement celle d’un homme qui a vu. Entrée dans sa maison, Mme Eberhardt a dû repousser la porte derrière elle, escalader son escalier et gagner sa chambre à l’étage. Peu de temps après l’inondation monta et devint torrent qui s’engouffra dans l’habitation. C’était un effroyable, un étourdissant vacarme, mais il ne surprit pas les indigènes d’AïnSefra. Ceux qui le purent prirent aussitôt la fuite ; les gens du Sud ont l’habitude de ces crues tumultueuses et rapides qui balaient le lit des oueds, emportent hommes, troupeaux et tentes, charrient les matériaux les plus lourds et abandonnent sur les rives les épaves les plus surprenantes.
Troublée et éveillée par les grondements de l’oued, Mme Eberhardt en reconnut la nature ; elle se précipita au bas de l’escalier pour tirer au large et se réfugier dans les hauts quartiers. La crue était déjà trop forte pour qu’elle parvînt à sortir de la maison. Le mascaret déferlait au rez-de-chaussée, elle fut empoignée par l’eau en furie. Affaiblie par la maladie elle perdit pied, fut étourdie, affolée, lancée contre une muraille, ne parvint pas à retrouver l’escalier sous le plafond surabaissé ; rejetée dans le réduit, assommée, elle se noya. Sa santé était encore très mauvaise. Sa sortie prématurée de l’hôpital était une grave imprudence ! Sûrement, elle n’offrit pas une longue résistance à la mort. Son mari ne se trouvait certainement pas avec elle au moment de sa mort, puis-je croire. Je ne me rappelle pas l’avoir aperçu ce jour-là à Aïn-Sefra. Je crois même qu’il n’assista pas aux obsèques de sa femme ; aucun de mes camarades ne l’y reconnut ni même n’entendit parler de sa présence aux obsèques. Dieu sait cependant combien Isabelle fut en ce temps-là le sujet de nos conversations ! Nous nous entretenions surtout de la fatalité dont elle avait été la victime. Si elle avait obéi au conseil du médecin, si elle n’avait pas quitté ce jour-là l’hôpital, elle aurait échappé à la catastrophe. Sous les ordres de mon lieutenant j’eus charge, les jours suivants, avec un camarade, de rechercher, dans l’état où l’inondation les avait mis, tous les papiers qui avaient été éparpillés à l’intérieur de la maison par le cataclysme ; notre fouille fut des plus consciencieuses. La plupart de ces écrits et bouts de journaux furent trouvés maculés de boue à l’étage ; nous les donnâmes à notre officier, qui les mit tant bien que mal à sécher. Tel a été le récit de M. Richard Kohn ; il donna à témoin de sa véracité M. le capitaine Timme, sergent de sa compagnie en 1904, et M. Nordi, ancien légionnaire, établi à SidiBel-Abbès. Dans une lettre, René-Louis Doyon m’a communiqué les observations suivantes sur le rapport de l’ancien légionnaire : « Isabelle, égrotante et fiévreuse, n’eut rien de plus pressé, au sortir de l’hôpital, m’écrit-il, que de joindre Ehnni venu du département de Constantine (ceci est confirmé par le général) . Le général Lyautey lui-même m’a fait dire cette leçon et qu’il hésitait entre l’ivresse de ce que je dis et celle de la dévastation offerte aux yeux d’une nihiliste telle qu’Isabelle ».
Robert Randeau
L'OASIS DE TIOUT - VERS MOGHRAR
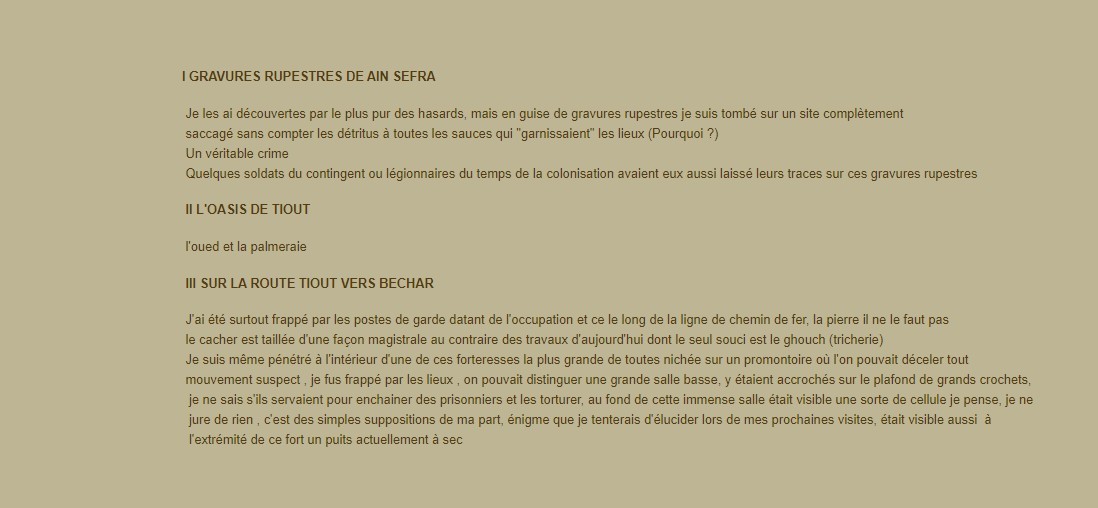
LES LIEUX VUS AVEC MON APPAREIL PHOTO
Photos prises le 06 octobre 2020
Le présent album comprend 141 photos
Cliquez sur la touche f 11 pour voir les photos en plein écran
NB / Si la musique ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Play du lecteur ci dessous
Commentaires (4)
- 1. | vendredi, 03 février 2023
- 2. | mercredi, 14 octobre 2020
- 3. | mardi, 13 octobre 2020
- 4. | dimanche, 11 octobre 2020
Paix à son âme