TADJEDDINE ABDERRAHMANE

ABDERRAHMANE TADJEDDINE
![]()
la haute stature d'un émigré
L'enfant d'El-Bayadh déborde d'humilité. Pourtant, il est physicien de dimension internationale et le premier regret qui percute l'esprit en apprenant qu'il vient d'être hautement honoré par la France est de se demander combien sont-ils ces cerveaux algériens qui sont dispersés à travers le monde et qui vont ailleurs loin de leur pays pour renouer avec la plénitude de leur savoir et de leurs compétences. Abderrahmane Tadjeddine est une pièce maîtresse du CNRS français. Dans la discrétion coutumière aux grands chercheurs, il en est un des patrons. Ecoutons-le.
Abderrahmane Tadjeddine, vous venez d'être décoré de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, mais qui êtes-vous?
Je suis Algérien, originaire d'El-Bayadh où j'ai fait mes études primaires et parallèlement j'ai appris l'arabe et le Coran sous la direction de mon père qui était imam. J'ai intégré l'Ecole normale d'Oran avec l'ambition d'être instituteur. L'Ecole normale de garçons ayant été incendiée par l'OAS pendant la guerre d'Algérie, ma promotion a été admise à l'Ecole normale de jeunes, à l'issue du concours dont j'ai été le major. La conseillère culturelle à l'ambassade d'Algérie à Paris m'a fait attribuer une bourse d'études supérieures pour le lycée Lakanal d'abord, puis pour l'Ecole normale supérieure de Cachan où j'ai entrepris des études de physique. J'ai été recruté au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1969. J'y ai soutenu une thèse sur «la caractérisation optique des interfaces électrochimiques».
Quelle a été votre carrière universitaire?
Après avoir soutenu ma thèse, j'ai gravi normalement les échelons d'une carrière scientifique de stagiaire à directeur de recherche de classe exceptionnelle, en évoluant dans ma carrière jusqu'à diriger un des plus grands laboratoires nationaux du CNRS en physique, jusqu'à mon départ en retraite en 2009 et mon admission comme chercheur émérite. J'ai aussi assuré la fonction de directeur scientifique adjoint à la direction générale du CNRS, en charge des grandes installations de recherche pour la chimie et les sciences du vivant. Cependant, soucieux de tous les étudiants algériens qui n'avaient pas eu ma chance et désireux de participer à leur formation, j'ai participé bénévolement, de 1978 à 1993, à la post-graduation de physique du solide de l'Université d'Oran Es-Sénia, en assurant des cours et séminaires et les accompagnant dans leur formation à la recherche, soit dans mon propre laboratoire, soit dans d'autres laboratoires français. Par ailleurs, outre les conseils que me demandent les rectorats d'Oran et d'Alger, nous sommes un petit nombre de chercheurs scientifiques arabes qui travaillons pour créer, en Jordanie, un centre scientifique de haut niveau pour assurer le rayonnement de la recherche dans les pays arabes. Outre ma participation à différentes opérations de recherche, j'ai contribué à la conception et à la construction en Jordanie d'un laboratoire d'excellence ouvert aux chercheurs des pays environnants. Mais la distinction que me remet aujourd'hui M. Alain Fuchs, Président du CNRS, est surtout la reconnaissance d'un travail scientifique internationalement reconnu et du redéploiement réussi des 350 chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs quand il a fallu arrêter les accélérateurs et fermer le laboratoire.
Après un tel parcours, aujourd'hui, que ressentez-vous?
Mes remerciements et ma reconnaissance vont, bien naturellement, à tous ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais une mention particulière revient à ma première directrice d'Ecole normale: dès les premiers mois de l'indépendance chèrement acquise, avoir rencontré une Algérienne, femme, jeune, intelligente, a été pour moi une révélation. C'est en cela que je suis devenu différent de ce que j'étais. Je vis encore cette richesse qui me vient d'une ouverture à l'autre sans aucune exclusive et je souhaite à notre jeunesse un avenir encore plus glorieux que le mien.
Article paru sur le quotidien d'Oran
![]()
Autre article paru sur El watan
ABDERRAHMANE TADJEDDINE, LAUREAT DE LA MEDAILLE RAMMAL DE PHYSIQUE
Directeur du laboratoire français de rayonnement synchrotron (lumière émise par des électrons à haute énergie), le Lure (Laboratoire pour l’utilisation du rayonnement électromagnétique) qui regroupe 400 chercheurs, Abderrahmane Tadjeddine, un physicien de carrière, est aussi un homme modeste et simple qui pose un regard généreux sur son pays d’origine. En somme, rien d’étonnant pour ce fils de nomade originaire de El Bayadh ! Arrivé en France au milieu des années 60 pour y préparer l’Ecole normale, il s’y installe et s’y fraye une carrière de physicien. A sa passion pour la physique, s’ajoute sa passion pour le pays. Un casse-tête ? Non… Avec des collègues algériens, il inventera le trait d’union entre les deux passions. Et c’est une collaboration scientifique entre Algériens et Français qui se construit au fil des ans, dès 1978. Une expérience fabuleuse à faire absolument connaître et à multiplier… Il nous en parle.
Vous êtes chercheur physicien et c’est en cette qualité que vous avez reçu la médaille Rammal …
Je suis physicien, chercheur en France depuis longtemps et présentement directeur du laboratoire du synchrotron français appelé le Lure qui est un laboratoire national qui a pour mission d’accueillir des chercheurs français et européens pour leur fournir le faisceau de rayonnement synchrotron pour la caractérisation de leurs échantillons.
Le Lure accueille-t-il principalement des physiciens ou est-il ouvert à d’autres chercheurs ?
Le Lure est un laboratoire interdisciplinaire qui va de la biologie, la physique, la chimie, les matériaux aux applications industrielles. La mission du Lure est, d’une part, de faire sa propre recherche qui utilise le synchrotron et, d’autre part, d’accueillir sur la base de projets discutés avec des experts indépendants du Lure des chercheurs dont le nombre s’élève à deux mille par an. Le tiers vient de la région parisienne, le reste vient des provinces et de l’Europe.
Quel est votre champ disciplinaire ?
J’ai un parcours assez original. Je suis de formation physicienne. J’ai fait l’Ecole normale supérieure de Cachan et après l’agrégation de physique, je suis rentré au CNRS (Centre national de recherche scientifique) comme physicien dans un laboratoire de chimie. L’objectif qui m’avait été assigné était de mettre au point des expériences d’optique qui pouvaient caractériser des interfaces électrochimiques. Mes recherches en électrochimie se sont soldées par une thèse de doctorat. Cela étant, j’ai toujours poursuivi un double objectif, d’une part, étudier cette interface pour comprendre la réactivité en fonction de la structure (les problèmes de la corrosion, de l’adhésion, de la catalyse) — un objectif fondamental dont les applications sont importantes, notamment les piles à combustibles, la conversion de l’énergie chimique en énergie électrique — et d’autre part, d’adapter les nouvelles techniques qui se créaient aux différentes problématiques tout en restant en contact avec les instrumentalistes de la physique ; c’est ainsi que je me suis retrouvé aux rayonnements synchrotron.
Pour revenir à la médaille, elle vient honorer une recherche particulière ou un parcours plutôt …
Surtout le parcours, je crois. Au-delà de l’activité scientifique qui a déjà été reconnue par mes pairs, cette médaille, et c’est bien pour cela que j’y attache beaucoup d’importance affective, vient recomposer un travail de longue haleine qui a commencé à l’université d’Oran en 1978 et s’est poursuivi jusqu’en 1992, lorsque la situation en Algérie a commencé à être difficile.
D’abord, pourquoi cette collaboration avec l’université d’Oran et quelle forme prenait-elle?
J’ai eu la chance de bénéficier de l’indépendance algérienne dans le sens où j’ai pu avoir une bourse que je n’aurais jamais obtenue si l’Algérie n’était pas indépendante ; j’avais fait l’école normale des instituteurs d’Oran et j’étais déjà instituteur lorsqu’on m’a proposé la bourse à l’Ecole normale supérieure de Cachan en France que j’ai intégrée par la suite. Une fois les études finies en 1969, j’envisageais de rentrer en Algérie, et je ne suis pas rentré pour la simple raison que j’avais envie de faire de la recherche et que les possibilités pour préparer une thèse ici étaient bien meilleures qu’en Algérie. Alors, je suis resté et j’avais mauvaise conscience. Puis, j’ai cherché à concilier un choix personnel, celui de rester en France, qui était motivé par la recherche avec l’envie de faire profiter mon pays de mon expérience. Et j’avoue avoir trouvé un formidable équilibre entre les deux. Mais pour pouvoir faire cela, il fallait que de l’autre côté, je puisse trouver un répondant. Des collègues algériens qui acceptaient de m’accueillir.
Ce sont vos collègues de l’université d’Oran qui vous ont accueilli, c’est cela …
Oui, exactement. Il faut bien comprendre que dans les années 70, ce n’était pas banal de recevoir un coopérant algérien. Il fallait un acte volontariste et je l’ai trouvé, justement avec Fewzi Benhabib qui était directeur du département des sciences exactes, à l’université d’Oran. Je l’ai contacté par une série de hasard et, tout de suite, on a pensé qu’il y avait quelque chose à faire. Pas des leçons à donner, non loin de là, mais s’intégrer dans un programme qui était déjà choisi et aider à le réaliser. C’était en 1978, dans le jeune institut de physique où une post-graduation venait de se créer que je me suis intégré. De façon totalement sauvage au début puisque la première fois, je suis venu en vacances et petit à petit, ma collaboration a commencé à prendre une forme plus officielle, puisque le CNRS, qui m’a permis par la suite d’y aller avec un ordre de mission pour pouvoir y travailler, a soutenu cette action. En même temps, je parrainais des étudiants qui venaient en France pour des thèses de magistère ou de doctorat.
Au fil des ans, vous avez établi une réelle collaboration scientifique entre votre laboratoire de recherche et l’université d’Oran…
En fait, plus que cela, la collaboration dépassait mon laboratoire, et je me suis retrouvé à être un peu le parrain de toute cette action scientifique en cherchant des laboratoires d’accueil pour tous les étudiants qui venaient pour une post-graduation que je parrainais et que je suivais jusqu’à la soutenance.
En avez-vous encadré quelques-uns ?
Oui, beaucoup. Je crois que jusqu’en 1990, j’étais l’Algérien qui avait encadré le plus grand nombre de magistères en physique. Je crois avoir encadré 24 magistères, parmi lesquels plus de 20 sont retournés en Algérie.
Vous avez tissé une toile d’araignée entre différents laboratoires…
Oui, j’aime bien l’expression. Il y avait Oran, mon laboratoire,
Paris Vl, Paris Vll, des laboratoires de Rouen et de Montpellier. Et j’insiste sur cette toile d’araignée qui s’est tissée grâce à un véritable travail d’équipe mis en place parce que j’étais reconnu comme un élément faisant partie de l’équipe d’Oran qui m’avait totalement adopté. Et tout cela se faisait de façon naturelle. Avec une intensité moindre, le même travail a été fait avec Sétif où avait démarré un laboratoire d’optique et de mécanique et j’ai accepté malgré toutes les difficultés, parce que je ne voulais pas que mon travail s’inscrive dans une visée régionaliste.
Pourquoi, que représente Oran pour vous ?
Oran est quelque part la ville de mes attaches affectives étant donné que ma mère y habite. J’étais dans mon milieu, totalement concilié avec moi-même.
Etant donné que votre démarche bousculait un peu les sentiers traditionnels de la coopération scientifique en Algérie, avez-vous été confronté à des obstacles ?
Enormes ! Les difficultés que j’ai eu sont liées au fait que du côté algérien, mis à part mes collègues de l’université d’Oran et en particulier le directeur d’institut, on n’acceptait pas ma collaboration.
Quelle explication donnez-vous à cela ?
D’une part, le fait que j’avais des relations relativement privilégiées avec les étudiants qui sont des relations faciles puisque j’étais indépendant du système, et d’autre part, le système au début n’acceptait pas l’idée de coopérants algériens en Algérie. Pourtant, c’était un moyen formidable d’impliquer des énergies ! Il me reprochait de ne pas rentrer mais en même temps il faisait tout (du point de vue administratif) pour compliquer les choses. Mais c’était secondaire, comme je n’allais pas pour être payé, ni pour être reconnu, ni pour les honneurs, la seule chose qui comptait pour moi c’était ce contact avec les étudiants et les collègues qui a toujours était formidable.
A partir de 1992, la collaboration s’est effilochée…
Je considérais que la nouvelle génération que j’avais formée devait s’affirmer et prendre ses marques. Mais je n’ai pas coupé ! Même lorsque la France avait interdit aux enseignants de se rendre en Algérie (il n’y avait pas d’ordre de mission) pour des raisons de sécurité, j’y allais. La dernière soutenance à laquelle j’ai assisté date du mois de mai de l’année dernière. Malheureusement dans le pays, la situation était telle que ceux avec lesquels je collaborais étaient menacés dans leur vie quotidienne et dans leur vie professionnelle, et beaucoup sont partis pour sauver leur peau ; il y a eu une désorganisation de la situation et je ne trouvais plus mes repères.
Considérez-vous qu’à partir de 1992, il y a eu un recul notoire au niveau de la recherche en Algérie qui correspond à l’état du délabrement du pays ?
Oui, totalement. A plusieurs niveaux. D’abord, parce les équipes ont été désorganisées, pas seulement pour des raisons sécuritaires, mais il y avait aussi un choix politique qui a appauvri les universités. Les moyens ont été diminués, mais en plus je n’ai pas le sentiment que les politiques ont été suffisamment rationnelles pour sauver ce qu’il y avait. La situation devenait totalement arbitraire.
A votre niveau, après tant d’années d’investissement, avez-vous le sentiment d’un gâchis collectif ? Regrettez-vous votre démarche ?
J’ai toujours considéré que l’important était de former les gens. Aujourd’hui, le département de physique d’Es Senia est encadré essentiellement par des anciens étudiants que j’ai formés ou que j’ai contribué à former. Franchement, je suis fier, très fier. Et puis, j’avoue que j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour eux, c’est pour cela que chaque fois qu’ils ont besoin de moi, j’y vais. Je pense que c’est aussi grâce à eux que l’université a pu tenir le coup ! Cela ne veut pas dire que je partage tout ce qu’ils font…
Une idée précise de l’université algérienne…
Nous avons les cadres formés, c’est dommage que nous n’ayons pas les politiques qui les soutiennent. Il y a un gâchis ! On en forme beaucoup mais on ne leur donne pas les moyens de s’exprimer en Algérie. La preuve, une fois qu’ils partent aux Etats-Unis, au Canada ou en Europe, ils s’insèrent dans d’excellentes équipes de recherche.
Justement, en parlant des chercheurs algériens en France, sont-ils nombreux ?
Dans mon laboratoire, il y en a cinq ou six de très haut niveau qui sont reconnus dans des domaines comme, la théorie des accélérateurs, la physique des surfaces ; dans tous les laboratoires il y a des jeunes et des moins jeunes d’origine algérienne qui participent à la vie scientifique des laboratoires et des universités. Les Maghrébins de langue française arrivent à être facilement recrutés malgré tous les handicaps objectifs que l’histoire a légués. C’est rare que je ne trouve pas trois ou quatre Algériens dans un laboratoire d’une vingtaine ou d’une trentaine de chercheurs et qui sont tout à fait dynamiques.
La médaille… elle représente quoi pour vous ?
Je suis d’autant plus ému d’avoir cette médaille que pour moi tout le travail que j’ai fait en l’Algérie, de façon personnelle, était un devoir, et je ne cherchais ni les honneurs ni les remerciements. Je n’ai pas demandé cette médaille, elle m’a été décernée grâce à des collègues que je ne connais pas et qui l’ont demandée pour moi.
Et sincèrement je suis comblé, j’ai toujours eu un problème moral, car je suis de l’âge des Algériens qui étaient trop jeunes pour faire la guerre d’Algérie, mais qui l’ont vécue de façon consciente et qui se sentent profondément Algériens et n’ont jamais voulu couper avec le pays. Etre reconnu pour cela, je trouve que c’est formidable ! Cette distinction dépasse de loin le strict domaine de ma spécialité et comble l’homme que je suis. Elle me remet de l’autre côté de la Méditerranée et me donne envie de relancer ma collaboration.
Un dernier mot…
Je voulais dire tout de même que la situation a fait que, lorsque les choses ont commencé à bien s’installer, notamment à Oran, en matière de recherche, un blocage a surgi. On a l’impression que ça a gâché un effort collectif de plusieurs décennies et que maintenant il faut tout redémarrer. Il faut le faire mais en même temps, il y a un goût amer… parce qu’on a le sentiment de redémarrer de plus bas encore. C’est frustrant !
Par D. Benhabib
La Médaille Rammal
Créée en 1993 par la société française de physique et la fondation de l’Ecole normale supérieure à la mémoire de Rammal Rammal, grand physicien libanais prématurément disparu (1951-1991), qui en souvenir des circonstances propres à sa vie était exceptionnellement brillant et particulièrement méritant, la médaille Rammal a pour but de promouvoir le message d’universalité de la science et d’honorer annuellement un physicien (pris dans un sens large incluant la chimie, la physique, la biophysique, les sciences de l’univers, les sciences physiques de l’ingénieur) du pourtour méditerranéen. Dès la nuit des temps, c’est dans cette région du monde que s’intensifièrent les échanges, créant un esprit d’ouverture et de recherche. Caractéristique du cheminement du savant franco-libanais, le partage du savoir a été le moteur de sa vie. En tissant des ponts entre son pays d’origine, le Liban, et son pays d’accueil, la France, où il fit ses études supérieures et ses recherches, Rammal Rammal originaire d’un milieu populaire du Sud-Liban a été un savant généreux attaché aux principes des droits de l’homme et de l’universalité. Souhaitant que son nom et son esprit soient perpétués, les scientifiques qui reçoivent cette distinction s’inscrivent dans cette lignée. Combien sont-ils ces scientifiques algériens à rêver orgueilleusement de partager leurs connaissances avec leur pays d’origine ? Nombreux, sans doute, éparpillés discrètement çà et là dans de grands laboratoires de recherche à travers le monde. Eh bien, Abderrahmane Tadjeddine est de ceux-là ! C’est d’ailleurs ce brillant physicien qui a reçu la médaille Rammal à l’Unesco, à Paris, le mois dernier.
Par D. B.
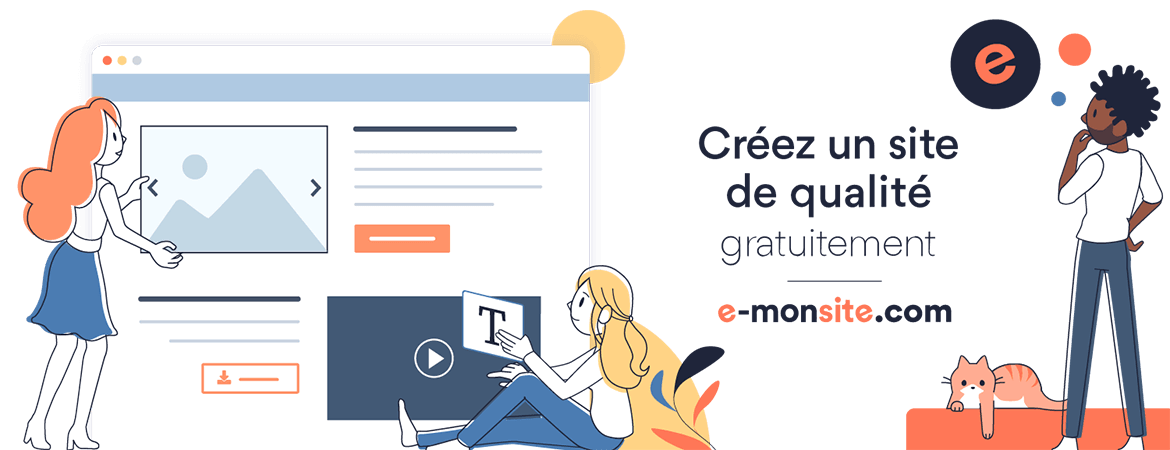
Commentaires (4)
s’enorgueillir , pour réussir comme il l’a fait c’est qu’il est super intelligent vu la situation de l’époque .il se plaint à juste
titre de la fuite des cerveaux en Algérie et qu’il essaie d’y remédier. on voit qu’il aime son pays .
Un ancien voisin de quartier