SUR LES PAS DE MICHHHEL. V

SUR LES PAS DE MICHEL VIEUCHANGE
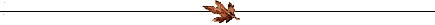
VOIR SMARA ET MOURIR
Nous ne pouvions trouver, plus belle et plus pure aventure que celle de ce jeune homme, vraie figure de proue
Qu’y a-t-il d’émouvant dans les carnets de route de ce jeune homme qui a désiré d’un cœur « impétueux cet endroit sur la carte au milieu des solitudes inhumaines où d’imperceptibles italiques forment les deux syllabes : Smara. Rien ne lui coûte, la fatigue, le danger, la faim, la soif, la nourriture grossière, l’eau pourrie, la vermine, les sables et les feux de l’Enfer. Il donne tout son argent, il se confie tout seul à quelques brigands dont la langue même lui est inconnue. Il passe des heures roulé dans un ballot, lié par les quatre membres comme une bête qu’on Sacrifie. Une première tentative échoue, il recommence. » Il réussit et revient pour mourir, après avoir souffert indiciblement dans son corps vidé par la dysenterie et par l’affreux galop d’une bête elle-même à moitié morte.
EN ROUTE VERS SMARA 

Il y a soixante-dix ans, le 22 septembre 1930, un jeune neversois de 26 ans, Michel Vieuchange, se trouvait quelque part dans l'extrême sud marocain, caché dans un village dénommé Tiglite qu'il décrit abondamment dans ses " carnets de route Il a quitté sa base de départ, l'oued Massa, dans la nuit du 10 au 11 septembre, pour une aventure insolite, un peu folle, mais déterminante pour lui.
Tiglite est situé dans le Noun, entre l oued Noun et l'oued Draa, au sud de Guelmim, l'ancienne cité caravanière de Goulimine. Depuis Tiznit, dernier poste contrôlé par l 'armée française à 150 km au nord, Michel Vieuchange se trouve dans une zone non encore pacifiée et plus ou moins soumise à un chef de tribu influent, le caïd Madani, nommé par le sultan mais échappant en réalité à son autorité.
Michel sur son dromadaire

L'oued Draa, à une vingtaine de kilomètres au sud, marque la limite méridionale extrême de l'influence marocaine et la séparation entre tribus sédentaires ou semi-sédentaires et tribus nomades. Vers le sud on entre vraiment en zone de dissidence, euphémisme pour parler d'une région qui échappe à toute autorité réelle, que ce soit celle du sultan du Maroc et de son administration, le maghzen, ou celle des puissances coloniales locales, la France et l'Espagne. Ces immensités désertiques encore insoumises sont livrées aux intérêts fluctuants des tribus sahariennes qui nomadisent entre le Noun au nord et l'Adrar mauritanien au sud, entre la côte Atlantique à l'ouest et le Touat algérien à l'est.
Au centre de la dissidence - pour les puissances européennes -, au centre de cet espace de liberté - pour les grands nomades - se trouve, quelque part à 300 km au sud, l'objectif de Michel Vieuchange, Smara.
•Dans quel contexte ce jeune intellectuel français se lance-t-il à la découverte de cette cité chargée de mystère ?
. Pourquoi et dans quelles conditions a-t-il entrepris cette aventure ?
• Comment l'a-t-il accomplie jusqu'à son issue fatale?
. Quels enseignements enfin peut-on en tirer ?
C'est à ces interrogations que je vais essayer de répondre de manière aussi concrète que possible dans le délai d'une heure qui m'a été imparti. Il restera une trentaine de minutes pour les questions qui surgiront peut-être sur une aventure plutôt singulière dans l'univers des explorations, sur un personnage qui suscite toujours des interrogations, enfin sur une région largement méconnue et qu'on se dispute encore de nos jours.
Pourquoi le Sahara occident,,il ? Que représente Smara pour Michel Vieuchange en 1930 ? Pour situer l'aventure, il faut la replacer dans le contexte de l'époque.
Le contexte politique régional ne favorise guère le projet de Michel Vieuchange. Pourtant, en 1930, nous sommes à l'apogée des grands empires coloniaux mais la pacification n'est pas achevée au Sahara occidental ou atlantique.
Les grandes conquêtes coloniales sont quasiment terminées ; les empires britannique, espagnol, portugais, italien et français notamment paraissent bien établis, puisqu'en cette même année 1930, pour ne citer que l'exemple de la France, on célèbre le rattachement de l'Algérie et l'on prépare l'Exposition Coloniale de Paris de 1931, en dépit des difficultés économiques, consécutives à la crise de 1929, qui commencent à barrer l'horizon des " puissances ".
Le désert de Smara

Seul l'empire colonial allemand a été démembré à la suite de la Guerre de 1914 - 1918 ; il est vrai que Berlin nous avait particulièrement gênés au Maroc en soutenant, par sa marine, son argent et des livraisons d'armes, le fils du fondateur de Smara, opposant farouche et irréductible au protectorat français.
Même si le Maroc vit depuis 1912 sous un régime de protectorat assez tolérant, la présence européenne est parfois encore mal acceptée par les populations, notamment dans les zones accidentées, et toujours combattue par les grands nomades sur les confins sahariens.
Si le " Maroc utile à la France " est bien protégé et en voie de modernisation rapide grâce à l'action déterminée et éclairée du maréchal Lyautey, il n'en est pas de même des zones montagneuses de l'Atlas, où il a fallu réduire une à une les tribus berbères. Sur les confins sahariens, 1 'hostilité à toute présence européenne et le fanatisme antichrétien, héritées du fondateur de Smara, le cheikh Ma El Aïnin, sont encore vivaces en 1930.
Smara du temps de sa splendeur

Michel Vieuchange vient d'effectuer son service militaire, comme élève-officier de réserve, dans un régiment de zouaves à Mazagan d'abord (l'actuelle El Jadida, au sud de Casablanca ) puis à Oujda dans l'extrême nord-est du Maroc de juin 1926 à août 1927. Il arrive donc peu après la reddition d'Abd El Krim (mai 1926) qui menait contre les Français et les Espagnols une véritable " guerre de libération " dans le Rif depuis 1921. Le rappel récent du maréchal Lyautey (octobre 1925), jugé trop conciliant à l'égard des autorités marocaines, permet au parti colonial de passer à l 'administration directe et de terminer la pacification en s'attaquant aux zones de dissidence, ce qui sera fait entre 1931 et 1934.
En dépit de ce contexte relativement favorable à un esprit aventureux, il ne semble pas que Vieuchange ait beaucoup " crapahuté ", comme disent les militaires, ni même ressenti à ce moment-là " l'appel du désert ". Il écrit qu' " il a besoin d'un peu de tendresse et qu'il vit parmi des brutes ", ce qui est tout à fait conforme à sa personnalité d'intellectuel bien élevé, mais peu en accord avec un tempérament d'explorateur.
Le Sahara Atlantique est alors divisé entre l'Espagne et la France. Les accords de 1900 - 1904 - 1912 ont délimité leurs zones d'influence respectives par un tracé artificiel des frontières et une répartition des tribus selon leur centre de gravité estimé, en respectant toutefois leur liberté de nomadiser selon les parcours traditionnels des grands nomades.
• à la France le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie,
• à l'Espagne le Maroc Espagnol, c'est-à-dire le Rif, l'enclave d'Ifni et la région de Tarfaya, ainsi que le Rio de Oro. En réalité, les Espagnols ne quitteront leurs comptoirs côtiers du sud (Ifni, Tarfaya- Cap Juby, Villa Cisneros, La Guëra) qu 'en 1934, lorsque la France les aura aidés à contrôler leurs possessions.
LES ETAPES DE LA PENETRATION EUROPEENE (1907-1934)
Le contexte local n'est guère plus favorable à une telle expédition, bien au contraire : l'expansion coloniale en Afrique du Nord a exacerbé les tensions entre sédentaires et nomades, voire entre tribus nomades ralliées et non ralliées ; l insécurité est alors générale dans les zones insoumises.
En dépit de cette ambiance d'insécurité, Michel Vieuchange s'apprête à partir à la découverte de Smara, cité mystérieuse située quelque part à 300 km dans le sud. C'est justement cette part d'inconnu à la fois géographique, religieux et politique qui fait frémir l'intellectuel.Nieuchange et l'attire aujourd'hui comme un aimant.
Il doit en effet pénétrer dans un véritable no man's land de 500.000 km2. Cet immense espace désertique, encore pratiquement inconnu, sauf de quelques explorateurs volontaires ou involontaires, ressemble à une sorte d'océan avec ses ports d'entrée et de sortie : Goulimine au nord, Ouadane dans l'Adrar mauritanien au sud, Tindouf à l'est, reliés, comme des routes maritimes, par des pistes caravanières qui suivent les points d'eau, sous le contrôle de tribus nomades qui s'y déplacent au gré des nuages.
Le Sahara atlantique n'a guère suscité jusque-là l'intérêt des puissances coloniales : la France est occupée à mettre en valeur les plaines marocaines et à prospecter les richesses minières. L'Espagne, qui a le protectorat sur la zone côtière depuis 50 ans, n'a pas quitté ses comptoirs du bord de mer, comme on l'a vu, et ne peut même pas garantir la sécurité terrestre des équipages des bateaux qui s'échouent sur ses côtes inhospitalières, ni a fortiori celle des aventuriers de l'Aéropostale dont les avions tombent en panne en cours de vol et doivent se poser en catastrophe dans le désert. Lorsqu'ils ne sont pas massacrés, ces explorateurs involontaires ne sont restitués que contre rançon. A leur libération, les revenants parlent d'une cité mystérieuse, située quelque part sur la Séguiet El Hamra, mais difficile à localiser, et qui semble être au cœur de toutes les négociations : Smara.
Depuis les années 1890, Smara est en réalité un foyer de résistance à la pénétration européenne qu'elle vienne du sud ou du nord du Sahara ; elle est encore en 1930 le cœur de la dissidence.
Lorsqu'au tournant du siècle le sultan du Maroc n'avait plus les moyens, notamment économiques et militaires, de lutter efficacement contre la pénétration européenne en Afrique du Nord et dans son ancienne zone d'influence au Sahara, il a favorisé les menées d'un marabout réputé, dénommé Ma El Aïnin (1830 - 1910), venu du sud-est mauritanien. Cet homme puissant a réussi à rallier les tribus nomades dans une véritable " guerre sainte " contre les " Naçrani " (les Nazaréens).
M. Vieuchange

Qui était-il ? Héritier de l'un des grands marabouts du Sahel soudanomauritanien, originaire du Hodh, il a étudié au Maroc et accompli le pèlerinage de la Mecque ; à son retour, il enseigne le Coran comme prédicateur itinérant dans l'ouest saharien qu'il parcourt en tous sens. Comme il est en même temps chamelier et commerçant caravanier, il devient un homme riche, influent et respecté des nomades. Le sultan du Maroc le consulte et l'appuie dans sa résistance à la pénétration française en Mauritanie en lui fournissant des subsides et de l'armement, puis en lui conférant le " khalifa " (la lieutenance) sur la Séguiet El Hamra.
Comme il n'y avait aucun lieu de culte pour les nomades entre Goulimine et Ouadane - le nomade doit prier en plein air-, Ma El Aïnin a eu l'idée de construire, avec l'aide du sultan, une mosquée à Smara entre 1898 et 1902. La cité du désert devient ainsi un centre religieux mais aussi un centre politique en même temps qu'un relais caravanier concurrent de Tindouf plus à l'est.
On trouve à Smara une école coranique et une bibliothèque, une mosquée en pierre mais à ciel ouvert, des habitations, des magasins et un dépôt d'armes ; alentour quelques habitations pour les familiers et des tentes pour les disciples.
Ma El Aïnin y séjourne jusqu'en 1909, suivant attentivement au sud la progression des Européens en Mauritanie, comme la décomposition du royaume chérifien au nord. Après avoir vraisemblablement commandité l'assassinat du gouverneur Coppolani à Tidjikja en 1905 et retardé la conquête française, il ne peut néanmoins empêcher que son fils et ses alliés mauritaniens soient battus en 1908. Au nord, le sultan du Maroc est prêt à composer avec les Français, aussi décide-t-il de quitter Smara et de remonter sur Tiznit avec ses "hommes bleus". Là il se pose en prétendant au trône chérifien et marche sur Fès ; il est battu par le général Moinier en juin 19] 0 et se replie sur Tiznit où il meurt en octobre.
Son fils, El Hiba " le sultan bleu ", s'empare de Marrakech en 1912 mais il est vaincu à son tour par le général Mangin et se réfugie dans l'AntiAtlas où il meurt en 1919. Ses frères, neveux et cousins vont poursuivre la résistance dans le sud marocain et au Sahara jusqu'en 1934. Le Noun, où stationne Vieuchange en ce 22 septembre 1930, est dans la sphère d'influence de Merebbi Rebbo, jeune frère d'El Hiba. C'est dans cette ambiance antieuropéenne, antichrétienne, que se situe l'expédition de Vieuchange.
Que représente encore Smara en 1930 ? Que sait-on de cette cité mystérieuse trente ans après sa fondation ?
Smara - La zaouia

C'est une " ville sainte " de l'Islam grâce à l'enseignement et à la réputation de savant de Ma El Aïnin. Dans sa zaouïa, il a formé des milliers de disciples qui entretiennent la flamme religieuse. A leur passage, nomades et telamid (disciples) fréquentent la mosquée et la bibliothèque. C'est une ville - symbole de la résistance des sahariens à la pénétration européenne. C'est également, pour les grands nomades, une étape du commerce caravanier.
Qui la connaît ? L'explorateur Camille Douls est passé sur le site en 1887 mais c'était avant la construction de la cité. En revanche, le Lcl Mouret, commissaire du gouvernement en Mauritanie, a effectué, en février 1913, à partir d'Atar, un raid de représailles de plus de 1000 km contre ce centre spirituel et politique des nomades. Plus récemment des aviateurs, à la recherche d'équipages enlevés, ont survolé la cité mais leurs rapports n'ont pas été rendus publics.
Que conclure de ce rapide tableau du contexte de l'aventure de Michel Vieuchange ?
* Vieuchange ne sert aucun dessein politique ou de renseignement, comme Foucauld l'avait fait au Maroc puis en Algérie. D'ailleurs il se défie de toute autorité officielle ou officieuse.
* Smara a déjà été découverte par Mouret en 1913, à partir du sud il est vrai. Des aviateurs ont dû y être retenus en otages.
• Vieuchange n'a pas de dessein scientifique sinon celui de contribuer modestement à situer Smara et à tracer un itinéraire d'accès par le nord.
Que vient chercher Michel Vieuchange à Smara ?
Sa personnalité est tout entière dans cette exploration. Son tempérament, sa formation, les conditions dans lesquelles il prépare son expédition sont révélatrices de ce que sera son aventure saharienne.
Michel Vieuchange est avant tout un idéaliste.
C'est un intellectuel qui se lance dans une aventure spirituelle à travers une épreuve physique unique, qui sera en réalité décisive pour lui tant au plan religieux qu'au plan humain puisqu'il en mourra. Dans une conférence qu'il a donnée il y a deux ans à la Société Académique du Nivernais, M. Jean-Pierre Harris, en brillant professeur de philosophie, a parfaitement répondu à cette interrogation. J'y souscris pleinement et je vous engage à vous y référer pour cerner la personnalité à la fois limpide et complexe de Michel Vieuchange. Pour moi, ce jeune intellectuel neversois se situe dans l'esprit et la lignée de Péguy et de Psichari, un autre saharien, pour lesquels il a une profonde admiration ; et c'est Paul Claudel qui dédicacera en 1932 ses " Carnets de route " mis en forme par son frère.
C'est donc une aventure personnelle, comme un défi à lui-même, qu'il prépare de manière intellectuelle pour un objectif spirituel : "s'accomplir dans une épreuve unique !". Car Michel Vieuchange n'est pas un sportif, sinon qu'il pratique un peu de course à pied dans un club parisien à la mode. Son éducation et sa formation à Nevers sont les plus classiques pour un enfant de la bourgeoisie locale.
C'est un littéraire pur : après Nevers où il fréquente le collège de Saint-Cyr - bien connu de nombre d'entre vous - et obtient son baccalauréat ès lettres, il poursuit des études littéraires à Paris où il " monte " en 1922 ; passionné par la philologie classique et les poètes grecs, il effectue un voyage en Grèce en 1923 et en tire un roman "mistralien" (Hipparète) ; il écrit aussi des poésies. A partir de 1925 il suit les cours de l'Ecole du Louvre tout en fréquentant les cercles littéraires parisiens (Rimbaud, Nietzsche,...) ; à l'issue de son service militaire en Afrique du nord, il produit un essai (Humanité des villes d'Afrique) ; il s'initie à la photographie et s'intéresse au cinéma ; il se lance même dans la rédaction de scénarios et l'on peut penser que, s'il avait survécu à son aventure saharienne, c'est cette voie de l'imaginaire qu'il aurait choisie.
Le service militaire au Maroc n'assagit pas notre neversois : il s'exalte au contraire pour les explorateurs sahariens du XIXème siècle, notamment Léopold Panet qui parcourut toute la côte atlantique depuis St Louis du Sénégal jusqu'à Mogador en 1850, et Camille Douls, le découvreur de l'ouest saharien en 1887. Son imagination s'enflamme également aux exploits des "chevaliers du ciel", les aviateurs des années vingt, les Costes, Mermoz, Guillaumat, Saint-Exupéry, notamment ceux de l'Aéropostale qui, au péril de leur vie ou de leur liberté, relient Paris à Dakar en faisant escale à Cap Juby - Tarfaya et Villa Cisneros au Sahara Occidental. Il admire tout ce qui est héroïque, mystérieux, humain ; bref, les êtres qui, dirions-nous aujourd'hui, ont un mental à toute épreuve.
C'est dans cet état d'exaltation spirituelle, où la force morale parvient à surmonter tous les obstacles, que Michel Vieuchange se prépare à l'accomplissement de sa mission. Son frère Jean écrit : "le besoin est né pour mon frère de s'appliquer à un acte difficile qui l'engage tout entier, corps et âme".
La préparation en métropole s'étale sur une petite année, de septembre 1929 à août 1930.
Elle est avant tout intellectuelle, destinée à conforter Michel Vieuchange dans sa décision. Comme le dit J.P. Harris "apparaÎt alors le nom magique de Smara, centre de brigandage et de fanatisme, cité sans sédentaires, lieu de rencontres précaires, d'associations provisoires pour des opérations de prédateurs exaltés".
Vieuchange à Tiglit

L'approche intellectuelle est complétée par l'étude des données géographiques disponibles : récits d'explorateurs et d'aviateurs, cartes et relevés topographiques, apprentissage de la photographie. Pour l'exploration proprement dite, Michel Vieuchange se munit de douze petits carnets de notes qui lui serviront à la fois de carnets d'orientation et de carnets de route pour relever ses découvertes et noter ses impressions ; il emporte également deux montres, deux boussoles et deux appareils photos 6 1/2 xII, avec lesquels il réalisera environ 200 clichés dont 48 à Smara.
En revanche, sa préparation physique laisse quelque peu perplexe l'observateur d'aujourd'hui. L'entraînement à la vie dans le désert se résume apparemment à un peu de course à pied et de marche pour étalonner son pas et apprécier les distances parcourues. Vieuchange se fie à son frère, qui est étudiant en médecine, pour sa pharmacopée : médicaments contre les plaies, la dysenterie, le paludisme, les morsures de serpents. Il prévoit également quelques aliments énergétiques de complément (chocolat, confitures, conserves de fruits) pour affronter les efforts de la vie nomade et pallier les carences alimentaires.
Campement de M. Vieuchange

L'évaluation du contexte marocain et saharien l'incite par ailleurs à une extrême discrétion : pas de contacts officiels ou officieux, pas même de dispositif de secours - sinon l'aide de son frère qui restera en base arrière avec l'argent de réserve pour intervenir s'il était blessé ou capturé - ; naturellement pas de couverture intellectuelle, scientifique ou journalistique, encore moins de mécène. L'aventure pure, nue, libre !
Parti de Marseille le 16 août 1930 pour Mogador, l'actuelle Essaouira, Michel Vieuchange aborde son expédition avec une résolution extrême et une confiance inébranlable, tout en demeurant aussi discret que possible sur ses intentions pendant les trois semaines qui précèdent un départ arrêté au 10 septembre.
Dès le 20 août, il contacte un vieil opposant à la France, un ancien ministre d'Abd El Krim qui est à Mogador en résidence forcée depuis la fin de la guerre du Rif en 1926. Le caïd Haddou sera son seul contact et intermédiaire important ; il va le mettre en rapport avec le Mahboul qui sera son mentor et à qui il fera totalement confiance ou presque. Son guide recrutera à son tour les quelques accompagnateurs indispensables pour la zone sédentaire puis pour la zone nomade et fixera les conditions de déplacement, car Vieuchange ne doit en aucun cas être reconnu pour un Français. Il voyagera donc déguisé successivement en femme berbère et en nomade saharien avec le litham sur le visage, à pied en babouches, à chameau ou, dans lès moments critiques, caché dans un couffin !
Dans ces conditions de discrétion avec, il faut le dire, un peu d'improvisation, le secret de la réussite est lié à la rapidité d'exécution d'un projet de plus de 1000 km aller-retour. Pour cela, Michel Vieuchange doit profiter de son moral élevé pour surmonter les difficultés physiques, notamment la fatigue et les problèmes de santé qui ne manqueront pas de surgir si l'aventure s'éternise. Ensuite une exploration rapide ne laissera pas aux " adversaires " réels ou supposés le temps matériel de réagir. Enfin, en cette saison, on peut escompter que Smara sera quasiment vide et laissera deux ou trois jours à l'explorateur pour profiter de sa "conquête".
Ce sera donc un raid de va-et-vient que va entreprendre Michel Vieuchange, avec les aléas de ce type d action toujours quelque peu improvisée et aux résultats incertains.
Suivons maintenant Michel Vieuchange dans son aventure saharienne qui va se dérouler entre le 10 septembre et le 16 novembre 1930.
Souvenez-vous, nous sommes le 22 septembre 1930. Michel Vieuchange se trouve à Tiglite, près de l'oued Draa, en limite de zone sédentaire et de zone nomade ; là il doit trouver des guides parmi les grands nomades du nord-ouest saharien (Régueibat, Izargiin, Oulad Delim, Tekna,...), qui sauront le conduire à Smara en évitant si possible les zones d'insécurité mais sans trop s'écarter des points d'eau.
Que s'est-il passé depuis le 10 septembre ? Ce jour-là, son frère Jean, qui assurera le recueil en base arrière à partir de Mogador, et lui-même quittent, en taxi, Marrakech avec leurs dernières emplettes ; - ils ne veulent pas partir directement de Mogador pour ne pas éveiller l'attention Ils vont gagner directement Agadir et l'oued Massa, à 30 km au nord de Tiznit, où a été fixé le départ de l'expédition à la tombée de la nuit du 10 au II septembre. En réalité les contretemps de ce long voyage en voiture font qu'ils ne parviennent au lieu de rendez-vous qu'autour de minuit. L'expédition démarre le 11 à lh30 du matin.
Tiznit

L'approche en zone sédentaire, une famille de six personnes - cinq accompagnateurs : trois hommes, deux femmes avec deux ânes et plus tard un chameau, Michel Vieuchange déguisé en femme berbère - se fait avec le maximum de discrétion ; on évite villes et villages, on campe à l'écart, Michel se teint le visage, les bras et les mains, les chevilles et les pieds, au permanganate pour ne pas éveiller l'attention. En dix jours (11 - 20 septembre), tant bien que mal - Michel manque manifestement d'entraînement à la marche en babouches en terrain accidenté et caillouteux ! - il a parcouru environ 220 km pour rejoindre ce village de Tiglite.
Le cheikh local, parent de Chibani, l'un des accompagnateurs, est plutôt bien disposé mais gourmand ; il doit agir discrètement et il a besoin de beaucoup d'argent pour acheter des chameaux, trouver des guides compétents et amadouer les différentes tribus qui viendraient à deviner la présence de ce "commerçant américain" intéressé par les ressources minières du sud marocain et du Rio de Oro. Grâce à deux ou trois accompagnateurs - relais, il peut correspondre avec son frère en base arrière et surmonter les difficultés inévitables ; argent, pellicules photo, carnets de notes, courrier circulent ainsi entre Tiglite et Mogador.
L'attente est toutefois plus longue que prévue : il faut négocier par intermédiaires, réunir l'argent nécessaire, même si ce délai permet à Michel Vieuchange de se remettre de ses fatigues et surtout de panser ses plaies aux pieds. Il perd ainsi treize jours (21 septembre - 3 octobre) dans l'inaction, la crainte d'être dévoilé et l'appréhension du danger, car il y a du " baroud " autour de Tiglite avec des morts et des blessés pour s'emparer d'un chameau au pâturage, voire même d'un âne qu'il a acheté et qui broute à proximité de son refuge !
Finalement un premier raid, à quatre personnes, Vieuchange, Mahboul, deux cheikhs - un Regueïbat et un Tekna/Aït Chogout - avec deux chameaux, est lancé en direction de Smara dans la nuit du 3 au 4 octobre. On prévoit d'atteindre l'objectif en six à sept jours. Mais au quatrième jour de marche, le guide Aït Chogout, blessé au pied par une épine, craint une infection et veut faire demi-tour ; l'autre guide le soutient et rebrousse chemin. L'expédition rentre à Tiglite ; elle a parcouru 340 km en 7 jours.
Ce contretemps provoque une nouvelle attente de deux semaines à Tiglite : le guide est rapidement guéri, mais Vieuchange doit soigner une cheville enflée et des pieds en mauvais état, faire acheter deux chameaux au souk qui se tient à plusieurs jours de marche de là, ramener des provisions, se faire acheminer des médicaments : il commence à souffrir de l'estomac et des intestins. Ces désagréments l'affectent quelque peu, mais il conserve un assez bon moral.
L'expédition repart le 24 octobre pour le raid décisif, avec quatre accompagnateurs et trois chameaux. Vieuchange emmène Mahboul, les deux guides et Chibani. Il compte atteindre Smara en sept jours. Pour franchir les 320 km qui les séparent de Smara, il faudra un peu plus de huit jours de marche difficile, en raison du vent, de la chaleur du jour, du froid de la nuit, des disputes entre les cheikhs sur l'itinéraire à suivre, de la crainte des pillards en embuscade. Aussi, à partir du 28 octobre, Michel Vieuchange se déplace-t-il enfermé dans un couffin accroché à flanc de chameau et c'est dans cet équipage qu'il arrive enfin en vue de Smara le 1er novembre 1930 à midi. Après avoir franchi les campements alentour (3000 nomades et 2000 telamid - disciples religieux -, estiment les guides), il parvient à la cité qui le fait rêver depuis plus d'un an et qui est momentanément vide. Il se libère de ses entraves pour prendre les premières photos.
Que voit-il à Smara? Deux ensembles de constructions : une grande casbah et la mosquée avec des maisons à demi détruites autour, en contrebas quelques palmiers ; plus loin, à 300 mètres, dans une dépression une petite casbah. Il visite d'abord la mosquée, puis la grande casbah carrée, enfin la petite casbah. Là il s'arrête pour placer dans une excavation la preuve de sa découverte ; dans un flacon d'alcool de menthe, il laisse, avec leurs cartes, le message suivant : "mon frère Jean Vieuchange et moi-même, Michel Vieuchange, Français, avons en commun fait la reconnaissance de Smara, chacun se chargeant d'une part de la mise en œuvre, mon frère du soin de me secourir au cas où, captif ou blessé, je l 'appellerais, moi-même pénétrant dans l'oasis le premier novembre mil neuf cent trente". Pendant que ses accompagnateurs font le guet aux quatre points cardinaux, il fait rapidement le tour de la ville pour prendre les dernières photos. Des nomades approchent ; il est 15 h 00, il faut s'en aller. Vieuchange est enfourné dans le couffin et s'éloigne de Smara son objectif atteint, mais insatisfait de n'avoir pu consacrer que trois heures, au lieu de trois jours, à sa découverte.
Michel Vieuchange devant Smara 1 Novembre 1930

Le chemin de retour va d'abord emprunter l'itinéraire aller puis celui de la première tentative pour gagner Tiglite en sept jours (310 km). Michel Vieuchange accuse la fatigue et doit voyager presque constamment à dos de chameau. Il est amaigri, fiévreux, il souffre des pieds et de plus en plus de l'estomac. Il doit surveiller les guides, emprunte à Mahboul son fusil et des cartouches pour le cas où... ; deux chameaux sur trois meurent d'épuisement. Néanmoins on atteint Tiglite dans la soirée du 7 novembre.
Pressé de gagner Tiznit qu'il espère atteindre en cinq jours, il fixe rendez-vous à son frère pour le jeudi 13 novembre à 2 km au nord de la ville. Mais les cheikhs, qui ont conduit un "roumi", et qui plus est un Français, à Smara, craignent pour leur vie et commencent par exiger d'être payés immédiatement ; à défaut, ils veulent le garder en otage ; ils tergiversent pour le laisser partir ; mais, le voyant affaibli mais ferme, ils décident tous de l'accompagner à Tiznit. Le départ a finalement lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre avec deux chameaux sur les trois achetés ou rachetés.
Mais le 13 novembre à 17h00, après 60 km de parcours et à 120 km de Tiznit, Michel Vieuchange est terrassé par une crise de dysenterie et ne peut plus se tenir à chameau. Pour ne pas retarder la marche , il est mis dans un couffin. En cours de route, ses accompagnateurs se disputent de nouveau sur son sort : est-il préférable de le tuer, de le livrer au caïd Madani ou d'aller jusqu'au bout ? L'appât du gain, la peur du caïd qui n'aime guère les Regeibat les amènent enfin à Tiznit le dimanche matin 16 novembre. Guettant son frère qui est retourné à Mogador, Michel Vieuchange épuisé, décide, dans la soirée, de se faire admettre à l'infirmerie du poste français.
Son frère l'y retrouve en piteux état le lendemain 17 novembre. Un avion de l Aéropostale l'emmène à l'hôpital d'Agadir le 18. Dans la nuit du 19 au 20, il appelle son frère, lui dit qu'il fait table rase de ses errements intellectuels passés et adhère totalement au catholicisme ; il fait venir l'aumônier. Après avoir dicté à son frère le 29 un télégramme à leurs parents, il meurt sereinement le 30 novembre au matin. Il a accompli son destin !
Michel Vieuchange a été enterré au cimetière d'Agadir près de la casbah. Aujourd'hui sa tombe se trouve au cimetière européen de la nouvelle ville d'Agadir. En effet, lors du terrible tremblement de terre subi par la ville en 1960 , le cimetière a été bouleversé et les corps ont dû être transférés. Sur sa tombe, on peut lire "Ici repose Michel Vieuchange, né à Nevers le 26 août 1904, décédé à Agadir le 30 novembre 1930 au retour de son voyage à Smara ".
Que retenir de cette aventure humaine singulière ?
Le pari a été gagné au prix fort, direz-vous. C'est exact mais cohérent avec l'objectif recherché " une aventure unique, un accomplissement ! Il a également été le premier Européen à découvrir Smara par l'itinéraire nord. A-t-il été victime de la malédiction de Ma El Aïnin adressé aux Naçrani qui violeraient la cité sainte de Smara, comme le murmuraient les nomades sur l'itinéraire de retour ? Le colonel Mouret a été tué à la guerre en 1915 et aujourd'hui, c'est le tour de Vieuchange.
Les conditions draconiennes de discrétion et de rapidité d'exécution qu'il s'était imposées, l'ont conduit à s'alléger au maximum. Pour assurer le succès de son raid dans le minimum de temps, il s'est contenté de très peu, notamment sur le plan du transport, de l'alimentation et de la santé, alors qu'il avait les moyens financiers de faire la reconnaissance à chameau. Or le contexte d'insécurité et les querelles de bédouins avides en ont décidé autrement : son organisme, peu entraîné aux privations et aux nourritures locales, ne pouvait tenir plus de deux mois de ce régime sous la chaleur ou dans le froid saharien, avec le plus souvent de l'eau saumâtre à boire, tout en parcourant en moyenne 40 km par jour. Selon les estimations de son frère, qui paraissent exactes, Michel Vieuchange a couvert 1374 km en 37 jours de marche effective.
Michel sur son lit de mort entouré par ses guides Mahboul agenouillé
et Mohamed

A-t-il contribué à la connaissance de cette région encore inviolée ou presque ? Indéniablement oui au plan géographique et topographique, avec l'apport supplémentaire et inédit de la photographie dans ce genre d'expédition : 200 clichés et des carnets de route précis. Par ailleurs ses annotations sur les caractères, même anecdotiques, des sédentaires et des nomades rencontrés, ne manquent ni d'intérêt ni de justesse pour qui les a côtoyés ; en tout état de cause, elles rejoignent les observations de Camille Douls quarante-trois ans plus tôt. Sa contribution décisive concerne bien entendu Smara photographiée du sol pour la première fois peu après la reconnaissance aérienne qui a eu lieu quelques mois auparavant. La cité de Ma El Aïnin ne sera " redécouverte " par les Espagnols que dans quatre ans (1934).
Mais la contribution majeure de Michel Vieuchange reste cette extraordinaire aventure spirituelle, l'accomplissement absolu de son destin : prouver que l'esprit domine la matière et retrouver au bout du compte la foi de son enfance " comme Claudel " dit-il au moment de sa conversion. Il avait 26 ans !
Tiré de vieux et différents écrits
Mis en ligne le 09 Aout 2025
Cliquez sur PLAY du lecteur ci dessous pour écouter la musique d'accompagnement
Haut de page
Commentaires (4)
- 1. | lundi, 18 août 2025
- 2. | mardi, 12 août 2025
Malheureusement je pense que Michel avait mal évalué cette dangereuse traversée, cette fin tragique aurait pu être évitée si Michel avait pris de bonnes chaussures et un approvisionnement suffisant et il avait les moyens
Mais c'était écrit (El mektoub) Dieu merci il avait réussi son pari malgré bien des aléas insurmontables pour bcp- Paix à son âme ,
Avec mes amitiés et pensées les plus sincères
PS/ Mes lointains ancêtres sont issus de ces contrées (Saguia El Hamra - le Rio de Oro)
- 3. | mardi, 12 août 2025
- 4. | dimanche, 10 août 2025
Certains l''ont payé de leur vie à l''image de M. Vieuchange qui nous a légué de très précieux témoignages
Le désert est beau mais ne pardonne pas surtout en ces époques lointaines et même de nos jours
L'aventure du jeune Michel Vieuchange est à la fois extraordinaire, émouvante et audacieuse!