LA CITE MYSTERIEUSE

SMARA LA MYSTÉRIEUSE
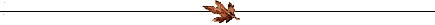
EN MARGE DE LA RÉCENTE ET TRAGIQUE RANDONNÉE
DE MICHEL VIEUCHANGE AU RIO DE ORO
Un jeune audacieux de vingt-six ans; Michel Vieuchange, vient de mourir à Agadir, de fatigue, de privations, de dysenterie, pour avoir voulu arracher son secret à Smara, la zaouia des sables, la ville mystérieuse du Sahara occidental, capitale des dissidences, citadelle du fanatisme, nid de brigands, d'où le grand marabout insurgé, Ma-el-Ainin, mena contre nous une lu.tte sans merci, et où se tient encore aujourd'hui le marché des armes de contrebande expédiées des Canaries, à l'usage des dissidents et coupeurs de route du Désert.
Smara, son fondateur le cheikh Ma-el-Ainin, notre ennemi acharné, c'est tout un chapitre, et des plus mouvementé de notre pénétration mauritanienne et marocaine qu'évoque cet événement.
Zaouia de Ma el Ainine

Depuis 1906, ce fut, en effet, de cette lointaine zaouia de la Seguiet-el-Hamra que rayonnèrent émissaires, marabouts et guerriers qui, fanatisés par le maître, s'opposèrent par tous les moyens à notre progression en pays maure. De là part également, en 1912, ElHiba, fils de Ma-el-Ainin qui, à la tête de ses Sahariens « les Hommes Bleus », se présente en régénérateur de la religion et en libérateur de la terre de l'Islam, se proclame sultan et s'installe à Marrakech, d'où Mangin dut l'expulser. Là enfin trouvaient refuge et accueil empressé tous les mécontents, tous les dissidents préférant quitter leur pays plutôt que d'accepter notre autorité, et les malfaiteurs ayant des comptes à rendre à la justice, en territoire occupé.
Le fondateur de Smara, Ma-el-Ainin, est fils de Mohamed-el-Fadel, marabout réputé de Chinguetti, la ville sainte de l'Adrar mauritanien. Il est frère d'un autre pieux et influent marabout du Trazza, CheihkSaad-Bou et, enfin, cousin du vénéré marabout du Hodh, Mohamed-Fadel, fondateur de la Confrérie des Fadelia, qui prétendait descendre du Prophète par la branche marocaine des Idriss. C'est à ce titre que Ma-el-Ainin et ensuite son fils, El-Hiba, se posèrent en légitimes héritiers de la dynastie idrissite et en prétendants au, trône chérifien.
Une semblable parenté ne pouvait que servir ses desseins ambitieux. Grâce à la réputation de sainteté qu'elle lui valut, grâce à son érudition (il composa des ouvrages de théologie dont la renommée est grande, surtout au Maroc), mais grâce-aussi, et pour une large part, aux pratiques de jonglerie et de prestidigitation dans lesquelles il excelle, Ma-el-Ainin réussit à s'imposer aux populations de l'Adrar, sur lesquelles il jouit bientôt d'une influence considérable.
Désireux de renforcer sa réputation par le mystère de l'éloignement et de la solitude, il quitte l'Adrar et, s'enfonçant dans le désert, crée, à 700 kilomètres plus au Nord, dans le Seguiet-el-Hamra, en territoire espagnol du Rio de Oro, la zaouia de Smara.
Il y fonde la Confrérie des Ainia, dérivée de celle des Quadriya, dont la zaouia mère de Smara a bientôt deux filiales, l'une à Marrakech, l'autre à Fez. Au cours des voyages qu'il entreprend pour visiter ces dernières, il est reçu avec considération par les sultans, sur qui il semble produire une profonde impression. On prétend même que Moulay Abd-el-Aziz, Moulay Hafid et beaucoup de hauts personnages furent affiliés à la secte des Ainias .
L'influence grandissante du cheikh de Smara sur les nomades sahariens : Ouled Delim, Regueibats, Teknas, fait bientôt concevoir au « pieux » marabout le projet de les utiliser à des fins temporelles et politiques, et tout d'abord à nous rejeter de l'Adrar et du Tagant, territoires qu'il considère comme réservés à son autorité.
Son hostilité se révèle par l'assassinat de Coppolani, dont il fut l'instigateur, alors que ce dernier avait réussi à atteindre Tidjikja, au cœur du Tagant et à obtenir, par des moyens pacifiques, grâce à son incomparable maîtrise des choses musulmanes, la soumission de nombreuses tribus.
Un R'guibi de la tribu des R'guibat

Ma-el-Ainin organise ensuite la résistance ouverte contre nous. Il écrit à tous les personnages influents de Mauritanie, religieux ou guerriers, leur enjoignant, au nom d'Allah, de prendre les armes pour s'opposer à notre avance et nous rejeter vers le Sud ; ses émissaires parcourent les campements, même ceux des régions soumises de la Basse-Mauritanie, prêchant la guerre sainte, promettant des secours en armes et en munitions et l'appui du sultan du Maroc.
Il intrigue en effet auprès de ce dernier à qui, dans l'espoir de l'intéresser à l'Adrar, il représente ce pays comme une région riche et une dépendance naturelle de son empire.
Moulay Hafid, sur ses instances, dépêche à Smara un chérif marocain, Moulay Idris, qui se dit l'oncle du sultan, envoyé par ce dernier pour chasser les Français de Mauritanie.
Il prend le commandement d'une importante harka de plus de 500 fusils et, après un premier succès à Niémilane, au Tagant, en 1906, est rejeté vers le Nord par. le colonel Michard.
Sans se laisser décourager par cet échec, Ma-elAinin, de son repaire de la Seguiet-el-Hamra, continue avec activité ses intrigues contre nous. Son action n'est pas seulement morale : il fournit nos adversaires d'armes à tir rapide et de munitions que des navires contrebandiers viennent débarquer à Mogador et au cap Juby, en dépit des protestations que nous adressons au sultan du Maroc.
es rares puits sont les endroits où se concentre l'activité du pays. Pendant le seif » en parti- culier, c'est-à-dire la saison de la soif, on y tire de l'eau sans arrêt jour et nuit, à l'aide de 5 à 6 poulies quelquefois pour le même puits, de façon à étancher la soif des habitants et des animaux. Malgré cela, il n'est pas rare que des animaux meurent de soif.
Le Maghzen se contente de réponses évasives, et la mauvaise foi du sultan nous est révélée par la circulaire adressée aux zaouias, dans laquelle il incite les musulmans à s'unir au cheikh Ma-el-Ainin, dans sa lutte contre les infidèles. Cette fetoua contenait également les suggestives déclarations suivantes : « Le sultan a comme amis les Allemands, qui sont très puissants... Les Allemands ont rendu de grands services au sultan; ils ont augmenté les revenus de son pays en créant des droits qu'il doit percevoir sur les marchandises, dans les escales... Ils lui ont également dit que, s'il était prouvé qu'il était le maître du pays contesté (la Mauritanie), ils se chargeraient eux-mêmes de l'affaire, si les Français ne voulaient pas l'abandonner. »
Cependant, après l'échec de Moulay Idris, le marabout de Smara se décide à conduire lui-même une sorba de guerriers maures jusqu'à Marrakech, pour obtenir du sultan une intervention contre nous.
Oued Draa

Peut-être espère-t-il également, en se montrant à la tête d'une aussi importante réunion de guerriers tout dévoués à ses ordres, une recrudescence de son prestige personnel sur les populations sud-marocaines, dont il escompte pouvoir tirer parti.
Malheureusement, le sultan est trop occupé au Maroc pour s'intéresser à l'Adrar ; il accorde aux guerriers sa bénédiction de chef des croyants et des promesses pour l'avenir. Quant à la population marocaine, elle est outrée du sans-gêne des « hommes bleus » du Sud, qui se conduisent chez eux comme en pays conquis ; elle a hâte de les voir s'éloigner.
Réduit à ses simples forces, Ma-el-Ainin, dès son retour à Smara, charge l'un de ses fils, Cheikh Hassan, d'organiser la lutte contre nous. Celui-ci va remplir cette mission pendant toute l'année 1908, avec une intelligence et une énergie remarquables et il faudra la colonne Gouraud, en 1909, suivie de notre installation définitive à Adrar, pour ramener le calme dans la région.
Notre occupation du pays porte une grave atteinte au prestige de « l'ermite de Smara ». Il songe à quitter sa zaouia pour s'installer à Tiznit, dans le Sud marocain, afin d'augmenter encore la distance qui le sépare de nous.
Moulay Hafid s'engage à rompre toutes relations avec lui et à empêcher que les agitateurs du Sahara reçoivent des encouragements et des secours en argent, armes et munitions. Il adresse des lettres dans ce sens aux autorités du Sous et de l'Oued Noun, .leur prescrivant de réprimer la contrebande des armes.
En réponse aux injonctions du Maghzen, Ma-elAinin, profitant de l'impopularité de ce dernier, qui pactise avec les chrétiens, et croyant son heure enfin venue, rassemble ses télamides sahariens, les fanatiques de l'Anti-Atlas et du Sous, jette le masque et se proclame sultan élu de Dieu. Recommençant l'épopée almoravide du xie siècle, il se met en marche sur Fez où il espère faire reconnaître ses droits au trône chérifien Sa marche triomphale fut interrompue par le général Moinier, qui défit ses bandes dans le Tadla en juin-juillet 1910.
Après cet échec, abandonné par la majorité de ses partisans, découragé, Ma-el-Ainin est réduit à rebrousser chemin le plus rapidement possible et à rejoindre Tiznit, où il meurt peu après, dans un complet dénuement. Son fils, El-Hiba, est désigné pour lui succéder, mais il ne possède ni l'influence ni l'autorité du vieux cheikh.
Néanmoins, avec ses nombreux frères : Cheikh Hassan, Merebbi Rebbo, Làghdaf, El-Oueli, Cheikh Nema, Taleb Khiar, l'héritier de la baraka » va poursuivre la lutte contre nous, lutte peu profitable d'ailleurs, marquée, au Nord, par son échec de 1912,
Cependant, Smara a perdu beaucoup de son importance religieuse et politique. Sa zaouia n'est plus guère fréquentée depuis le départ de Ma-el-Ainin pour Tiznit. Les héritiers de la baraka, El-Hiba, puis Merebbi Rebbo, le détenteur actuel, se sont installés, peu après la mort de leur père, à Kerdous (50 kilomètres au sud-ouest de Tiznit).
Après cet échec, abandonné par la majorité de ses partisans, découragé, Ma-el-Ainin est réduit à rebrousser chemin le plus rapidement possible et à rejoindre Tiznit, où il meurt peu après, dans un complet dénuement. Son fils, El-Hiba, est désigné pour lui succéder, mais il ne possède ni l'influence ni l'autorité du vieux cheikh.
Néanmoins, avec ses nombreux frères : Cheikh Hassan, Merebbi Rebbo, Làghdaf, El-Oueli, Cheikh Nema, Taleb Khiar, l'héritier de la baraka » va poursuivre la lutte contre nous, lutte peu profitable d'ailleurs, marquée, au Nord, par son échec de 1912,
Cependant, Smara a perdu beaucoup de son importance religieuse et politique. Sa zaouia n'est plus guère fréquentée depuis le départ de Ma-el-Ainin pour Tiznit. Les héritiers de la baraka, El-Hiba, puis Merebbi Rebbo, le détenteur actuel, se sont installés, peu après la mort de leur père, à Kerdous (50 kilomètres au sud-ouest de Tiznit).
Au point de vue de l'insécurité du désert, la situation demeure cependant la même ; sise en territoire espagnol du Rio de Oro, ce qui ne nous permet pas d'y intervenir, protégée par l'impuissance de- nos voisins à agir contre les nomades, la région de Smara et de la Seguiet-el-Hamra est restée l'un des principaux refuges des pillards et l'un des centres où s'organisent et d'où partent les rezzous qui, périodiquement, cherchent à piller nos confins algériens, mauritaniens et soudanais.
C'est sur ce pays, jusqu'à nos jours presque entièrement inconnu, que la récente randonnée de Michel Vieuchange vient d'attirer l'attention. A vrai dire, quelques voyageurs avaient déjà parcouru la région ; mais il ne leur avait pas été possible d'en rapporter des renseignements détaillés et précis.
Avant la création de la zaouia de Smara, deux indigènes, agents du gouvernement du Sénégal, et un Français, traversèrent la région de la Seguiet-el Hamra.
En 1850, le Sénégalais Léopold Panet, qui avait, reçu du ministère de la Marine et des Colonies, la mission de se rendre de Saint-Louis à Alger à travers le Sahara, se joint à une caravane de marchands maures ; mais, détroussé par ses compagnons de route, il traverse avec les plus grandes difficultés le pays des Regueibat, la Seguiet-el-Hamra, l'oued Draa et atteint Mogador, d'où il s'embarque pour la France. Il publia le récit de son voyage dans la Revue coloniale et algérienne (1850); mais cette relation n'est intéressante qu'au point de vue peinture du caractère et des mœurs maures. Elle est insignifiante au point de vue géographique et scientifique.
Campement nomade

Dix ans plus tard, un autre indigène sénégalais, Bou-el-Mogdad, assesseur du cadi de Saint-Louis, est envoyé à la Mecque, par Faidherbe, désireux de s'attacher un homme paré du titre envié de « hadj » (pèlerin) ; mais il lui impose comme condition d'effectuer la première partie de son voyage jusqu'au Maroc, par voie de terre, afin de recueillir sur son passage tous les renseignements qui pourraient nous être utiles. Il traverse à son tour la région de la Seguiet el-Hamra, l'oued Draa, et arrive à Goulimine, capitale de l'Oued Noun, où il se documente sur l'actif commerce des Teknas de cette région.
Outre ces renseignements commerciaux, la relation de son voyage est, comme celle de Panet, surtout intéressante au point de vue des mœurs des populations maures qu'il rencontre sur sa route. Enfin, en 1887, Camille Douls, dont l'intrépidité rappelle celle de Vieuchange, se fait débarquer au hasard, en un point de la côte du Rio de Oro, voisin du cap Garnet et cherche à se faire passer, auprès des Ouled Delim qu'il rencontre, pour un commerçant musulman. Reconnu presque aussitôt par un chrétien, il est pillé, frappé et enterré jusqu'au cou dans le sable brûlant. Ayant la présence d'esprit, dans cette situation de réciter à haute voix quelques versets du Coran, les Maures craignent de s'être trompés et le libèrent.
Douls mène la vie du campement qui l'a recueilli, le suit dans ses pérégrinations vers l'Est, jusque dans rlguidi, puis vers le Nord, dans la Seguiet-el-Hamra et l'Oued Noun.
Il se fiance à une jeune fille maure et obtient l'autorisation d'aller, dans son pays, chercher la dot. Il peut ainsi atteindre Marrakech, et de là Mogador, d'où il est rapatrié.
A peine de retour en France, il revient au Maroc; d'où il veut atteindre Tombouctou ; mais, aux premières étapes de son voyage, il est étranglé par ses guides, qui s'emparent de ses bagages.
Le Tour du Monde -publia, en 1888, la relation de sa première exploration (Cinq mois chez les Maures nomades du Sahara) ; elle est malheureusement, elle aussi, très pauvre en renseignements scientifiques.
C'est quelques années après le voyage de Douls que Ma-el-Ainin, quittant l'Adrar, fonde la zaouia de Smara. Elle devient bientôt un centre d'attraction puissant pour tous les dissidents du Sahara occidental. C'est là qu'arrivent les armes débarquées clandestinement par des barques Canariennes, armes qui sont ensuite distribuées à tous les dissidents du Sud et même de l'Atlas. C'est là que se forment les rezzous' qui viennent assaillir nos campements soumis ; c'est de là enfin que part le razzia conduit par Laghdaf qui, dans la nuit du 10 janvier 1913, surprend et détruit le peloton méhariste du lieutenant Martin, à Liboérat.
Smara - Tombes esseulées

Le colonel Mouret, commissaire du gouvernement général en Mauritanie, se trouvait précisément en Adrar. Il rassemble aussitôt toutes les forces mobiles disponibles, et, à la tête d'un groupement de 400 méharistes encadré par 9 officiers et 8 sous-officiers français, il se lance vers le Nord, à la poursuite des agresseurs. Il atteint Smara. La zaouia est vide ; les Ahel Mal-el-Ainin, au nombre de plus d'un millier, armés de fusils à tir rapide, ont fui vers l'Est. Il se porte à leur rencontre et, à l'issue du dur combat de l'oued Tagliat (affluent de sable de la Seguiet-el-Hamra), l'ennemi abandonne le terrain, y laissant 98 cadavres.
Le colonel Mouret avait l'intention de renouveler son raid l'année suivante, et, lui donnant plus d'ampleur, de réaliser la liaison avec les troupes sud-marocaines. Il avait donné, avant son départ en France, des instructions très précises aux unités méharistes de Mauritanie pour la préparation de cette randonnée. La guerre ne lui permit pas de mettre son projet à exécution.
Telles sont, jusqu'à la récente exploration de Michel Vieuchange, les seules tentatives de pénétration dans cette région encore presque inconnue du Sahara occidental.
Cette fois, c'est du Nord que part le voyageur.
Ayant quitté Tiznit le 10 septembre, il traverse la région située au nord du Draa, déguisé en femme, mêlé à une famille d'indigènes. Arrivé à une oasis de Draa, il réussit à trouver des guides pour le conduire à Smara, et continue sa route sous le costume d'un marabout.
Une malencontreuse rencontre avec un djich de pillards, qui reçoit à coups de fusils la petite caravane à laquelle il s'est joint, l'oblige à rebrousser chemin vers le Nord à toute allure. Il rejoint la vallée du Draa après une course à chameau de 220 kilomètres en quarante-huit heures.
Quelques jours après, il repart et atteint enfin Smara, le 1er novembre, ayant traversé 300 kilomètres de terres inexplorées.
Camille Douls

Pendant son séjour de deux mois dans la Seguia, il put rassembler une ample moisson de notes et d'observations scientifiques. Malheureusement, au retour, ayant atteint l'Oued Noun, sa mission terminée, la dysenterie le terrasse. Son guide le ramène à dos de chameau, jusqu'à Tiznit. De là, il est transporté d'urgence, en avion, à l'infirmerie d'Agadir où, malgré tous les soins qui lui furent prodigués, il ne tarde pas à succomber.
Son frère, Jean Vieuchange, collaborateur de l'entreprise, continue la tâche commencée. Il a pu recueillir des souvenirs précieux, un nombre considérable de renseignements de tous ordres, ainsi qu'une abondante collection de clichés, documents uniques sur la région.
La relation qu'il publiera sous peu, du voyage de Michel Vieuchange, — un nouveau nom à ajouter à la liste déjà longue du martyrologe saharien , portera la lumière sur une des dernières régions encore inconnues de la terre d'Afrique.
Lieutenant-colonel Gillier
Photos ajoutées par mes soins et libres de droit
Commentaires (2)
- 1. | vendredi, 15 août 2025
- 2. | vendredi, 15 août 2025




Absolument mon ami
Sans ce colonialisme SMARA aurait connu un rayonnement et une dimension tout autre